C'est très rare mais ça arrive. Les
Fantasiestücke opus 12 de Schumann, une des œuvres de lui que je préfère,
n'existent pas. Elles existent bien entendu comme œuvre, comme texte imprimé, elles existent dans ma tête, dans mes fantasmes, mais je n'ai jamais entendu de version de ces fantaisies qui me satisfassent pleinement. Il ne me vient à l'esprit, à l'instant, aucune autre œuvre du répertoire pour laquelle une semblable situation se présente. Il en existe, mais, la plupart du temps, fort heureusement, nous
identifions une œuvre musicale avec l'une (et parfois même plusieurs) de ses multiples interprétations. Le terme d'
interprétation, bien que juste, n'est pas pleinement satisfaisant. Ce n'est pas seulement d'une interprétation qu'il s'agit, bien qu'il s'agisse de cela pour une très grande part. Jouer les
Fantasiestücke de Schumann n'est pas uniquement l'interpréter, au sens propre et inévitable (puisqu'il est manifestement impossible de jouer une œuvre de manière totalement objective (ce n'est même pas d'ailleurs qu'il soit impossible de le faire, c'est d'abord et avant tout qu'on ignore ce que pourrait bien être le fait de "jouer une œuvre de manière objective" (il m'est arrivé, dans mes moments de folie, de chercher ce que cela pouvait bien vouloir dire, en utilisant l'ordinateur (le bien nommé) pour lui faire jouer une partition à sa manière qui n'en est pas une, et je n'en ai pas été beaucoup éclairé))), jouer les Fantasiestücke consiste d'abord à les
jouer, c'est-à-dire à les faire exister, à les rendre audibles, à leur donner une forme sonore susceptible d'être
comprise (encore un terme qui demanderait à être défini précisément, mais ce n'est pas le moment), donc
entendue, par un auditeur. C'est toute la différence avec les autres arts : n'importe qui peut prendre un livre de Heidegger en main et s'en faire une idée par lui-même, n'importe qui peut aller au Louvre et regarder un tableau de Poussin, et dire : j'aime, ou je n'aime pas. Il est possible que le lecteur ne comprenne pas vraiment Heidegger, mais il aura au moins la sensation de comprendre les phrases qu'il lit, même si elles perdent pour lui l'essentiel de leur résonances et si leur sens proprement philosophique lui semble confus ou abscons, même si, les lisant, il est en plein contre-sens. Il est probable que le contemplateur de Poussin aura l'impression de voir ce qui se trouve sur la toile, de repérer des personnages, un décor, une heure du jour et peut-être la saison qu'ils habitent, même s'il est probable qu'il passe à côté de l'essentiel. Mais si l'on met la partition des
Fantasiestücke entre les mains d'un non-musicien (même mélomane), cela ne lui dit à peu près rien sur la musique dont elle est la
trace écrite. Ou plus exactement, cela lui dit bien quelque chose
sur la musique, cela le renseigne
sur cette musique, et il y trouvera bien des détails et des motifs (surtout dans le hors-texte, dans les didascalies musicales que sont les "nuances" et autres signes d'interprétation) qu'il n'avait pas soupçonnés en tant qu'auditeur, cela lui apprendra des choses
sur et
autour de la musique (car une partition n'est pas que musique, elle est aussi
texte, elle est aussi
dessin, forme et formes, signes (certains dont je viens de parler sont dans
le domaine public, sont écrits "en français")), mais il ne
l'entendra pas (donc ne la
comprendra pas), malgré toute sa bonne volonté. Pour le dire autrement, il peut apprendre beaucoup, mais pas l'essentiel, qui est
hauteurs + rythmes, au minimum. La partition reste
lettre morte, ou dans le meilleur des cas
langue étrangère : Il ne l'oit pas, il ne l'entend pas, il ne la comprend pas. Au moins oit-on une langue étrangère ; si on ne l'entend pas, on peut l'écouter (c'est d'ailleurs souvent un grand plaisir que de ne pas comprendre ce qui se dit tout en entendant des mots). Le non-musicien est dans l'impossibilité d'écouter (seul) la musique qui se trouve sur une feuille de papier, il lui faut un médiateur, pour ce faire, l'instrumentiste, l'interprète, le musicien, le
joueur. Depuis l'invention de l'enregistrement et de la reproduction sonores, on a tendance à l'oublier, celui qui
joue, et c'est parfois un grand bonheur, mais ce qu'on entend quand on "met un disque" n'est qu'un simulacre sonore, le haut-parleur ne frotte pas un archet sur une corde, il ne frappe pas des cordes ou une peau avec des marteaux ou des baguettes, il ne met en branle aucune corde vocale, il ne fait qu'agiter l'air qui se trouve entre lui et vous. Et pourtant, le paradoxe est que ce simulacre sonore est bel et bien
la musique. En un sens, il l'est encore plus — la musique – que ce que nous entendons lorsque nous allons au concert, en nous coupant du
visuel, et il l'est infiniment plus, pour l'auditeur, en tout cas, que la lecture d'une partition.
La musique est vraiment un art à part, celui où le contre-sens n'existe pas et où le malentendu est omni-présent (il est même possible que ce soit l'inverse). Elle est également le seul art où les tricheurs sont instantanément démasqués. Je peux faire une exposition demain matin, sans jamais avoir appris à dessiner, à peindre, sans avoir la moindre "technique" que ce soit, je peux écrire un livre entier sans avoir la moindre idée de ce qu'est la littérature, sans connaître ni Tolstoi ni Homère ni Balzac, et sans même être contraint par les règles de la syntaxe ou de la grammaire. On voit ça tous les jours. Je peux difficilement monter sur scène pour jouer l'opus 111 de Beethoven sans posséder un certain
répondant technique — un pianiste sans
pianisme sera immédiatement identifié avec juste raison à un escroc ou à un fou (c'était du moins vrai jusqu'à tout récemment). La musique se rapprocherait en cela de l'architecture (un immeuble doit tenir debout, avant même qu'on sache s'il est beau ou laid), mais n'importe qui a la certitude de pouvoir voir un bâtiment, et ce même n'importe qui n'a en effet besoin d'aucun intermédiaire pour voir la tour Effeil ou le Louvre, il n'a qu'à ouvrir ses yeux. Le plus immatériel des arts est aussi le plus intransigeant, celui qui réclame le plus de travail, celui qui s'en laisse le moins compter.
"Qu'à ouvrir ses oreilles" ? Mais comment fait-on ? Comment fait-on pour ouvrir quelque chose qui n'est jamais fermé ? À partir de quand commence-t-on à écouter ? Écoute-t-on jamais ? Récemment, j'ai été très frappé par la réaction d'une jeune élève de piano, à qui je disais (de manière un peu ridicule) : « Et maintenant, je vais t'apprendre à écouter. » Elle a ouvert de grands yeux, m'a regardé comme si j'étais fou, et m'a répondu : « Mais c'est ce qu'il y a de plus facile ! Il n'y a
rien à faire ! »
Enseigner le rien, on voit par là mon intrépidité. Non seulement j'avais la prétention d'enseigner le rien, mais en plus je croyais pouvoir enseigner quelque chose que je ne suis pas certain de savoir faire moi-même. Au moment où j'écris ces mots, j'entends le troisième mouvement du seizième quatuor de Beethoven. Est-ce que je l'écoute ? Non. Est-ce que je l'entends ? Oui et non. Pour l'entendre, il faut le connaître d'abord. Et pour le connaître, comment fait-on ? Il faut commencer par l'écouter, mais surtout l'entendre. Mais personne ne m'a jamais appris à écouter, et encore moins à entendre… Quatre verbes, en français, sont au cœur de ce problème semble-t-il insoluble : ouïr/écouter/entendre/comprendre. On peut penser que je les ai écrits
dans l'ordre, l'ordre qui indique l'éveil de la conscience, de la volonté, de
l'entendement, précisément. Mais rien n'est moins sûr. Bien sûr, l'"ouïr" semble premier, car il nous est donné à la naissance, comme à tous les animaux, pour lesquels l'ouïe est le sens fondamental, celui qui prévient du danger. Avant d'aller au concert, il s'agit de rester en vie. C'est la raison pour laquelle nos oreilles ne possèdent pas de paupières : c'est un sens qui doit
sans cesse rester en alerte. C'est également la raison pour laquelle mon élève prétend qu'il n'y a rien à faire pour entendre. Elle n'a pas tort : on ne cesse d'entendre, même en dormant. Et ce n'est pas seulement "ouïr", ce qu'on fait alors, car il faut bien
interpréter les sons qui parviennent au cerveau, il faut bien les discriminer, selon leur sens, porteur ou non de danger. On est donc immédiatement dans le "comprendre", qui semble court-circuiter l'"écouter". C'est là qu'intervient, croit-on, ce merveilleux verbe français,
entendre, qui signifie à la fois ouïr et comprendre, mais également, et peut-être surtout, ne signifie ni l'un ni l'autre.
Longtemps, Beethoven m'a intimidé. Quand mon maître me donnait une de ses sonates à travailler, je le faisais, bien entendu, et avec un immense plaisir, encore, mais en même temps je ne pouvais m'empêcher de dire : "je ne comprends pas cette musique". Quelque chose en elle me restait tout à fait étranger, me résistait, alors que c'était sans doute le compositeur le plus entendu à la maison, depuis mes premières années. L'
Empereur, la
Pathétique, l'
Appassionata, l'
Héroïque, la
Pastorale, la
Cinquième, la
Neuvième, le concerto pour violon, le Printemps, etc., toutes ces œuvres faisaient partie
naturellement de l'ambiance sonore dans laquelle nous étions élevés. Nous ne les écoutions pas, nous les entendions. La langue maternelle était le français, la langue paternelle était
le Beethoven. Ces deux langues, nous les
entendions. Sans peut-être, sans toujours les comprendre… C'est ce que j'ai compris quand j'ai dû, non plus
écouter, mais
lire Beethoven.
Quand on est enfant, on
joue de son instrument. L'interprétation ? Connaît pas. On joue du piano, on joue avec le piano, le piano se joue de nous, parfois, mais on ne songe jamais ce faisant à la traduction d'une langue dans une autre. Pourquoi faire, puisque nous entendons ! Et tout à coup, vers l'adolescence, on comprend qu'il s'agit là de
poésie, c'est-à-dire de quelque chose de pas tout à fait normal, que cette langue pourtant familière n'est pas la langue de tout le monde, qu'elle passe à travers une sorte de filtre, de boîte noire, de chambre sourde, qui va lui donner un éclat singulier, qui va la rendre étrangère au "monde des sons", de la même manière qu'un écrivain, lorsqu'il l'est vraiment, écrit toujours dans une langue étrangère, même quand il écrit dans sa langue maternelle. La musique n'est à l'évidence pas "du son", comme on s'escrime aujourd'hui à tenter de nous le faire croire. Le son sert à nous
renseigner sur ce qui nous entoure, à nous
prévenir. La musique servirait plutôt (à condition qu'elle serve à quelque chose) à nous
enseigner, et, si elle nous
prévient de quelque chose, c'est uniquement de la mort inscrite dans la vie (ce qu'il y a de plus singulier en nous), et de cette dernière lorsqu'elle survit à la mort, lorsqu'elle la traverse, comme l'absence traverse la présence, et l'être, toujours.
Quelqu'un me demandait il y a peu ce que j'aimais "comme musique, à part la musique savante". Mais, à part la musique savante, il n'y a rien, "comme musique". La musique est savante ou elle n'est pas. Même lorsqu'elle est "populaire". La musique, c'est précisément ce quelque chose de plus que le son, ce quelque chose qui demande à être
entendu, qui exige de se faire
écouter, et, si possible,
comprendre. La chanson, puisque souvent c'est d'elle qu'il s'agit, quand on vous pose ce genre de questions, a précisément besoin
d'autre chose qu'elle-même pour exister, que ce quelque chose soit "les paroles" (que je distingue du "texte" de la chanson), ou de tout un contexte sentimentalo-sociologique qui dépend entièrement
de l'époque. Il va sans dire qu'il en va de même pour le rock, le rap, la pop-music, et tout ce genre de choses qu'il est inutile de nommer. La Messe de Guillaume de Machaut, même privée de son contexte historique et du faisceau de sens qui sans aucun doute l'accompagnait au moment où elle fut écrite, est toujours écoutable, et le sera encore dans cinq siècles. Il reste
quelque chose, même si l'on ôte ce que les critiques d'aujourd'hui aiment appeler le
sous-texte, quelque chose qui résiste au temps, aux effets de mode, aux inévitables transformations du goût, aux sensibilités éminemment diverses, parfois contradictoires, des individus qui composent la race des mélomanes. Cette faculté de la musique à rester vivante, même cinq siècles après que l'auteur est mort, est bien entendu à relier à ce qu'il est convenu d'appeler la
technique, qui, rappelons-le, veut dire "art", en grec. Il est à cette occasion permis de faire observer que les grandes œuvres se passent en général très bien de "mode d'emploi", alors que les laborieuses constructions conceptuelles de l'art dit "contemporain" (et je ne parle pas là uniquement des "arts plastiques") nécessitent en général des kilomètres de texte pour arriver à nous convaincre qu'il y a quelque chose à voir (ou à entendre). On ne doit surtout pas expliquer en quoi l'opus 111 (ou le 21e concerto de Mozart) est une des œuvres majeures de l'art occidental. La
pédagogie, à ce niveau-là, relève de la faute morale. Tout le monde n'écoute pas l'opus 111 le matin en prenant sa douche ? Et alors ? "Aucoun' importanz", comme disait Picasso à une dame qui lui reprochait de peindre des choses qu'elle n'aimait pas. Et même s'il n'existe que cinquante personnes en France pour l'écouter régulièrement, l'opus 111 reste cependant, quoi qu'on fasse, une des œuvres les plus considérables qui aient vu le jour depuis que le monde est monde. Si un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, les Français dans leur ensemble écoutaient régulièrement l'opus 111, c'en serait fini de la vie de l'esprit, et, même, de la
possibilité de la vie de l'esprit. Que cette œuvre, entre autres, soit à ce point
éloignée de la possibilité d'être aimée du plus grand nombre est la garantie que l'art est encore l'un des buts les plus hauts de l'esprit humain. Et si l'on voulait à toute force faire en sorte qu'elle le soit — aimée –, du plus grand nombre, il faudrait pour cela faire descendre les dieux parmi nous, en les mettant à notre niveau, ce qui aurait pour effet immédiat de les supprimer de manière radicale et définitive. Mais il est vrai que la chasse aux dieux est un sport très pratiqué en nos temps de démocratisation radicale. Depuis que nous autres Français avons guillotiné le roi, et qu'en plus d'avoir commis cet assassinat abject nous nous en vantons et en commémorons le jour, le raccourcissement et l'aplatissement de tout ce qui fait mine de surplomber un tant soit peu l'ordinaire sont devenus la seule geste autour de laquelle nous nous consolons d'être ce que nous sommes.
On peut connaître l'opus 111, on peut savoir cette œuvre par cœur, savoir à chaque instant quelle note va succéder à telle note, sans pour autant avoir idée de ce qu'est l'opus 111. L'étrange est que la musique, comme je le disais plus haut, la musique de l'opus 111, se tient tout entière dans ce qui arrive à nos oreilles, et pourtant, j'en jurerais, il n'est pas possible de savoir réellement ce qu'il en est sans avoir lu la partition. J'ai l'air de me contredire, mais je crois vraiment que
l'essence de l'opus 111, pour autant qu'elle existe, ne se situe ni dans le phénomène sonore qui nous est donné lorsque nous l'entendons joué, ni dans la partition qui nous sert à le jouer, et pas non plus dans
l'interprétation que nous en donnera un pianiste, fût-il le plus grand, et qui ne sera finalement que
l'écart entre ce que nous lisons et ce que nous entendons, le
jeu (au sens mécanique du terme) que ce pianiste introduira entre des signes et ce qu'ils signifient pour nous. Ce sens, cette essence, ne peuvent donc pas s'appréhender sur le champ, instantanément, mais se construisent dans le temps, grâce à la mémoire, à l'expérience, à la mémoire et à l'expérience de nos sens, donc à leur inscription dans notre corps, tout autant qu'à celles de notre esprit. C'est à partir du moment où l'on prend conscience du caractère étrange et "étranger" de la musique de Beethoven qu'on est en mesure de pouvoir, enfin, s'approcher d'elle. Et ce caractère étrange nous est en général donné au moment où l'on
travaille une œuvre, où la confrontation entre partition et jeu (comme ensemble de possibles sonores) se matérialise par le truchement de
l'instrument. C'est un paradoxe. Nous devrions nous familiariser avec une œuvre (et c'est bien le cas, en un sens), et ce travail nous en éloigne, parce qu'il nous met face à un texte qui se met à révéler sa véritable nature, et qui, pour advenir, emprunte des chemins que jamais nous n'aurions imaginés. L'interprétation est sans doute l'histoire de ces multiples détours indispensables, de ces jeux incessants d'approche et d'éloignement, qui permettent aux musiciens de rencontrer dans le même temps une œuvre
et son compositeur, quand ils acceptent pour ce faire de se perdre un peu eux-mêmes.
Dans le cas des
Fantasiestücke opus 12, tout se passe pour moi comme si personne n'avait encore rencontré
à la fois l'œuvre et le compositeur. Il est à peu près certain que je me trompe, mais pourtant cela me paraît indiscutable. C'est ce qui me fait dire qu'elles n'existent pas. Qui sont donc ces compositeurs qui ont le culot de composer des œuvres inexistantes, et, parmi celles-ci, d'y glisser de purs joyaux ? Pour qui se prennent-ils, ces compositeurs ? Nous méprisent-ils assez pour se livrer à ce genre de facéties, pour nous tenir éloignés de leur musique, pour nous en priver, dans le même temps qu'ils nous les proposent ? Pourquoi faire naître un désir inassouvissable ? En réalité, cette aporie ressemble au sens profond de toute la musique qui, en un sens, n'existe pas, car pour l'entendre il faut la connaître, et pour la connaître il faut l'entendre. On pourrait dire cela autrement : la musique se
reconnaît bien plus qu'elle ne se connaît. Elle implique toujours qu'on soit
en avance sur ce qu'elle nous propose, pour être en mesure de l'écouter vraiment. En cela réside, je crois, le secret de l'écoute musicale. On ne peut pas écouter
au présent. Mais, pour être capable d'écouter
en avance sur le son, il faut avoir une connaissance de
la musique, de la musique dans ce qu'elle a d'immuable, au travers de ses formes infinies. Il faut se sentir (au moins un peu) chez soi dans la musique pour pouvoir en éprouver l'étrangeté qui lui donne toute sa saveur. Il ne s'agit pas d'exotisme à proprement parler, car l'exotisme est toujours un peu m'as-tu vu et comme tel déjà connu, déjà catégorisé, il s'agit d'une qualité qui ne se laisse pas prendre, ni réduire, ni même intimider par des écoutes régulières et assidues, il s'agit d'un je-ne-sais-quoi qui nous devance, qui est toujours au-delà de nous, qui est comme la flamme, à la fois brûlante et insaisissable. On voit bien qu'il y a de la lumière, et qu'elle réchauffe, mais on ne peut pas la toucher, l'arrêter ou la faire naître à volonté. On comprend bien que le temps et cette flamme sont faits de la même matière, mais on ne connaît pas cette matière. C'est ce qui est si excitant lorsqu'on prend une partition et qu'on la pose sur le pupitre.












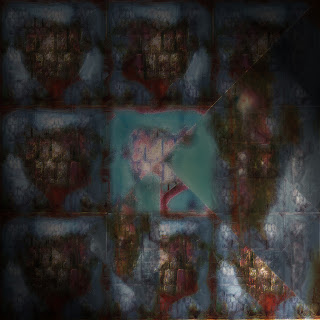










.jpg)


