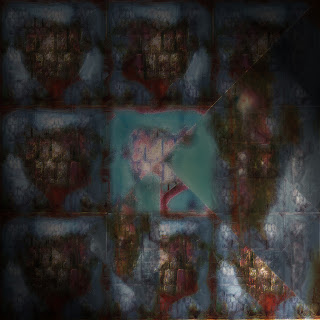« L'oubli n'est autre chose qu'un palimpseste. Qu'un accident survienne, et tous les effacements revivent dans les interlignes de la mémoire étonnée. »
Affichage des articles dont le libellé est Architecture. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Architecture. Afficher tous les articles
dimanche 17 avril 2022
samedi 8 juin 2019
Des corps sur le décor
Vous ne les voyez plus parce que vous les voyez trop. Partout, elles sont là. La moindre surface est utilisée. Il n'y a plus que la terre battue qui n'est pas encore marquée par la publicité. Ça viendra. Les marques sont omniprésentes, à Roland-Garros. Les joueurs eux aussi sont nikés, et même les petits ramasseurs de balles. Je dis les marques, mais ce qui marque, ce qui étouffe, même, c'est cette impression écrasante que les grandes entreprises sont là chez elles, que le sport (ou même le spectacle) n'est qu'un prétexte pour les mettre en évidence, pour vous les enfoncer dans la tête. On est cerné, on est camisolisé par cette puissance économique qui montre froidement ses muscles sur fond vert. Et d'ailleurs ce n'est même pas que ces entreprises auraient quelque chose à nous vendre, non, c'est seulement qu'elles veulent nous montrer qui est aux commandes, pour quelle et par quelle raison on est là. Ça ne se discute pas. Elles sont là, elles sont bien là, elles sont le cadre, la scène, les coulisses, elles sont le carburant et le véhicule, elles sont l'esprit et l'intrigue. Les Federer, les Nadal, les Williams passeront, elles seront toujours là, même si entretemps elles ont changé de nom. Toutes ces gloires du sport sont éphémères, ainsi que leurs caprices, leurs exploits et leurs personnages. Ils ont eu et auront leurs heures de gloire. C'est tellement peu de choses, pour Engie, BNP Paribas, Peugeot, Fly Emirates, Roleix, Perrier, Lacoste. La seule gloire qui ne passe pas, c'est l'argent, c'est la puissance, c'est le pouvoir. C'est la concentration du pouvoir et de l'argent.
Il ne s'agit pas de marques. Il ne s'agit pas de luxe. Il ne s'agit pas d'entreprises. Il ne s'agit même pas de banques. Il s'agit de se croire libre dans un monde qui ne le permet pas.
jeudi 6 novembre 2014
Boléro sans musique
Il y a cette cinquième entrée du thème A, à peu près à la moitié de l'œuvre, géniale combinaison de timbres, que j'ai très longtemps entendue de travers. J'étais persuadé qu'il y avait un orgue positif dans l'orchestre, alors que le résultat est obtenu en mélangeant le cor avec le célesta et deux picolos harmonisés à la tierce et à la quinte (tout est dans le dosage des intensités, évidemment…). Rien que pour ça, on écouterait le Boléro vingt fois de suite.
Béjart, quand il parle de sa chorégraphie, explique que le danseur principal est "la mélodie" et que les autres sont "le rythme". Il est évident que c'est complètement faux, et, du coup, on imagine ce que serait une chorégraphie qui serait vraiment ce qu'il dit de la sienne. Mais surtout, quelle magnifique chorégraphie on pourrait composer en suivant exactement la partition de Ravel… La très grande majorité des chorégraphies que j'aie vues dans ma vie me semblaient pécher par ce travers : une incompréhension foncière de ce qu'étaient les musiques qu'elles étaient pourtant censées "illustrer".
Le Boléro, c'est un ensemble de choses. Une progression dynamique d'abord. Un rythme. Une harmonie. Une orchestration bien sûr. Un tempo. Une, ou plutôt deux mélodies. Une modulation. Une construction (deux séries de neuf énoncés de la mélodie, entrecoupées d'une ritournelle rythmique, plus une coda).
On a parlé d'une étude d'orchestration, et c'est la pure vérité. Mais je crois que c'est plus que ça. Si cette musique a pris une place tellement singulière, dans l'imaginaire populaire, c'est que son caractère éminemment abstrait a disparu derrière autre chose.
Cette cinquième entrée, on la goûte vraiment quand on a travaillé avec les synthétiseurs et qu'on a connu le plaisir de construire un timbre en superposant des sons sinusoïdaux, des harmoniques. Ce qu'on nomme la synthèse additive pourrait être une des nombreuses métaphores du Boléro. Tout est dans le dosage des harmoniques. On est toujours entre deux états : celui où les harmoniques se fondent et composent un timbre unique, et celui où elles s'individualisent. L'orchestre en son entier est conçu comme un gigantesque synthétiseur, ou comme un orgue formidable. L'exécutant ajoute des timbres, actionne les tirettes de l'orgue, au fur et à mesure, il mélange les couleurs, pendant que la machine joue toute seule, imperturbable.
Toutes les musiques sont toujours un jeu sur le même et l'autre, sur le semblable et le différent, sur le changement et la permanence. Ça s'entend plus ou moins mais c'est toujours là.
Faire ressentir la durée : donner à entendre le temps qui passe, on pourrait dire que n'importe quelle musique le fait. Mais écouter le Boléro, c'est comme faire passer le temps à travers un tamis. Nos oreilles sont les témoins de ce qui reste ; c'est comme une vague qui traverserait un tableau de part en part et en révélerait les couleurs au fur et à mesure. Plutôt que de donner à entendre le temps qui passe, c'est rendre audible le temps qui nous traverse, lui donner une forme et une matière, une épaisseur, en garder la trace sensible, le faire sonner…
Dans la musique électronique des commencements, un dispositif a joué un rôle énorme : le Ring Modulator, ou "modulateur en anneaux". Un modulateur en anneaux est un instrument électronique qui, lorsqu'on lui injecte deux fréquences, produit deux fréquences nouvelles qui sont, respectivement, la somme et la différence des deux fréquences initiales. Par exemple, si, dans le Ring Modulator, vous injectez les fréquences 440 et 660, vous obtiendrez en sortie les fréquences : 1100 et 220, qui s'ajouteront aux deux premières. La modulation crée des hauteurs différentes de celles dont on dispose avant la modulation. Il s'agit donc d'une sorte de multiplication de fréquences qui, par le biais des harmoniques multiples d'un son instrumental, produit des sons complexes et inharmoniques dont le célèbre DX7 a beaucoup usé pour produire des sons de type "cloche". Un RM peut créer très facilement des sons très complexes à partir de sons simples, par un effet de multiplication exponentielle des composants harmoniques du son. Si un son instrumental possède dix harmoniques, y compris la fondamentale, ce même son "ring-modulé" en possèdera trente, et le rapport qu'il entretiendra avec le son original sera dès lors très lointain, bien qu'apparenté.
Le Boléro de Ravel, c'est un peu une machine — un processus instrumental et compositionnel – qui agit avec la matière musicale comme le RM avec les sons. Vous lui donnez en entrée des composants simples (un rythme, une mélodie, un instrumentarium, un tempo), et, à l'autre bout, en sortie, vous obtenez une matière musicale très sophistiquée. On a l'impression que ça fonctionne tout seul, et je pense que cette impression de création sonore automatique (et quasiment magique) n'est pas pour rien dans la fascination qu'exerce cette musique depuis bientôt un siècle.
Ravel était passionné par l'horlogerie…
Le Boléro de Ravel, c'est un peu une machine — un processus instrumental et compositionnel – qui agit avec la matière musicale comme le RM avec les sons. Vous lui donnez en entrée des composants simples (un rythme, une mélodie, un instrumentarium, un tempo), et, à l'autre bout, en sortie, vous obtenez une matière musicale très sophistiquée. On a l'impression que ça fonctionne tout seul, et je pense que cette impression de création sonore automatique (et quasiment magique) n'est pas pour rien dans la fascination qu'exerce cette musique depuis bientôt un siècle.
Ravel était passionné par l'horlogerie…
« Je souhaite vivement qu’il n’y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre. Elle représente une expérience dans une direction très spéciale et limitée, et il ne faut pas penser qu’elle cherche à atteindre plus ou autre chose qu’elle n’atteint vraiment. Avant la première exécution, j’avais fait paraître un avertissement disant que j’avais écrit une pièce qui durait dix-sept minutes et consistant entièrement en un tissu orchestral sans musique – en un long crescendo très progressif. Il n’y a pas de contraste et pratiquement pas d’invention à l’exception du plan et du mode d’exécution. Les thèmes sont dans l’ensemble impersonnels – des mélodies populaires de type arabo-espagnol habituel. Et (quoiqu’on ait pu prétendre le contraire) l’écriture orchestrale est simple et directe tout du long, sans la moindre tentative de virtuosité. […] C’est peut-être en raison de ces singularités que pas un seul compositeur n’aime le Boléro – et de leur point de vue ils ont tout à fait raison. J’ai fait exactement ce que je voulais faire, et pour les auditeurs c’est à prendre ou à laisser. »
« Dans le Boléro, Ravel semble avoir voulu transmettre à ses cadets une sorte de manuel d’orchestration, un livre de recettes leur apprenant l’art d’accommoder les timbres. Avant de quitter la scène pour aller à son rendez-vous avec la mort, ce Rastelli de l’instrumentation a exécuté avec le sourire la plus éblouissante et la plus brillante de ses jongleries. » (Émile Vuillermoz )
Ce qu'il y a d'amusant, avec le Boléro de Ravel, c'est qu'il plaît beaucoup à ceux-là mêmes qui en général détestent ce qu'ils appellent un peu bêtement l'Art contemporain, cet art qui précisément, très souvent, fait exactement ce que fait ici le compositeur.
samedi 25 octobre 2014
Braise et farde

Une femme peut tout, fait tout impunément, Lorsque d’un précieux et rare diamant, Son collier à nos yeux étale les merveilles, Ou que de lourds pendants allongent ses oreilles. Qu’une épouse opulente est un pesant fardeau! Du soin d’entretenir la fraîcheur de sa peau, Chez elle à tout moment on la trouve occupée; Son visage est enduit des pâtes de Poppée: Elle en est rebutante, et l’époux caressant, A la glu, sur sa bouche, est pris en l’embrassant Elle se nettoiera, si son amant l’appelle. Qu’importe à la maison qu’on soit plus ou moins belle? Ce n’est que pour l’amant qu’on soigne ses attraits, Que des parfums de l’Inde on s’inonde à grands frais Alors le masque tombe, on lève les compresses; Elle entre dans un bain fourni par des ânesses Dont, fût-elle exilée aux plus rudes climats, Elle ferait traîner un troupeau sur ses pas. D’emplâtres, de parfums dégoûtant assemblage, Que dire? est-ce un ulcère? ou bien est-ce un visage Mais depuis le matin suivons-la jusqu’au soir. L’époux a-t-il, la nuit, trompé son tendre espoir? Gare aux femmes d’atour! intendante, coiffeuse, Toutes vont lui payer cette injure odieuse. Le Liburne est venu trop tard: malheur à lui ! Il sera châtié pour le sommeil d’autrui. L’un rougit de son sang les verges ; L’autre, tunique bas, reçoit les étrivières; Celui-là du bâton se sent meurtrir le dos. On en voit, à l’année, employer des bourreaux. On frappe! elle relève un journal de dépense, On fait à son amie admirer l’opulence D’un tissu rehaussé de larges franges d’or. On frappe. Elle se farde. On frapperait encor; Mais les bourreaux sont las. Allons, c’est fait, dit-elle, Sortez. De Phalaris la cour fut moins cruelle. Veut-elle, en nos jardins, au milieu des Laïs, Ou devant les autels de la commode Isis, Se montrer plus parée encor qu’à l’ordinaire? Une Psécas tremblante, empressée à lui plaire, La sein nu, les cheveux assemblés au hasard, Accourt pour lui prêter le secours de son art. Misérable! pourquoi cette mèche trop haute? Soudain le nerf de bœuf a puni cette faute. Ce crime qui jamais ne peut être expié, Cet horrible forfait d’un cheveu mal plié! Cette pauvre Psécas ! quel excès d’injustice ! Si ton nez te déplaît, faut-il qu’elle en pâtisse? Le côté gauche enfin, sous des doigts plus savants, Se démêle, se roule en longs anneaux mouvants, Là se trouve et préside une vieille édentée, De l’aiguille aux fuseaux avec l’âge montée. Elle opine d’abord, et les jeunes après, Comme lorsqu’il s’agit, en un grave procès, De sauver d’un client ou l’honneur ou la vie! Tant elle a de briller une indomptable envie! Au port de cette femme, à ses cheveux bouclés, En étages nombreux sur son front assemblés, En face vous diriez d’Hector la veuve altière; Mais quelle différence à la voir par derrière! Je le crois aisément, puisque, sans brodequin, Ce n’est plus qu’un pygmée, un ridicule nain, Et que, pour embrasser l’objet de sa tendresse, Sur la pointe des pieds il faut qu’elle se dresse! Cependant elle court au lieu du rendez-vous, Néglige sa maison, laisse là son époux. Avec lui désormais elle vit en voisine; La seule affinité, c’est qu’elle le ruine, Et que, pour l’affliger, se croyant tout permis, Elle bat ses valets et chasse ses amis.
mercredi 30 avril 2014
Bruit
Il y a des gens avec lesquels il est absolument impossible de parler. Soit qu'on ne comprenne pas la langue qu'ils utilisent (et ça devient de plus en plus courant), soit qu'on ne comprenne que trop qu'ils ne parlent pas pour nous parler, pour dire quelque chose, mais pour faire avec leurs mots une sorte de muraille de signes, une sémiogenèse stérile, qu'ils dressent entre eux et nous.
mercredi 12 mars 2014
Mettre toute la vaisselle sur la table
Il faut entendre le Duke annoncer « Sam Woodyard », son batteur, il faut entendre toute la gourmandise sonore qu'il met dans ces quelques syllabes, pour comprendre ce qu'est le plaisir dans la musique. Sam Woodyard n'a jamais eu de professeur, dans sa vie de musicien. C'est Clark Terry, assis près de lui, qui lui expliquait les morceaux, au fur et à mesure qu'ils les jouaient avec Ellignton. « Gaffe-moi ça, tout le monde va essayer de se débrouiller… » Sam Woodyard va apprendre la batterie en accompagnant l'orgue de Milt Buckner, c'est une très bonne école, d'accompagner un organiste, pour un batteur, quand il s'agit d'entrer dans un big-band. Pousser un organiste, c'est un peu comparable à pousser les quatorze musiciens d'un big-band, quand on est de la section rythmique. Sam n'est pas un bon lecteur, mais il possède une excellente oreille et une bonne mémoire. Mais surtout, il met tout son cœur à jouer pour l'orchestre, pas pour lui. Depuis le début, il a toujours fait ainsi, en pensant à l'orchestre avant de penser à lui, à la batterie. Duke Ellington avait le don très sûr de savoir recruter les musiciens qui étaient à leur place, dans l'orchestre, en plus d'être les meilleurs. Johnny Hodges, Cootie Williams, Ben Webster, Ray Nance, Jimmy Hamilton, Sonny Greer, Cat Anderson, Russell Procope, Paul Gonsalves, Clark Terry, Aaron Bell, etc., ce ne sont pas seulement de merveilleux instrumentistes, ce sont aussi et peut-être surtout de fantastiques musiciens d'orchestre.
Un jour que Billy Strayhorn demandait, lors d'une séance d'enregistrement : « Où est ma partition ? » Sam (qui n'en avait jamais) enchaîna : « Et la mienne ? » À quoi, Tom Whaley (copiste) répondit en lui faisant passer une feuille de papier sur laquelle était inscrit un simple "P", qui pouvait signifier : « Sois Personnel. » Ou bien : « Sois Prêt. » ou encore : « Sois Présent. » Duke avait une expression particulièrement destinée à son batteur, qui tenait lieu de partition et de grand P : « Mets toute la vaisselle sur la table ! », qui est une très vieille expression du Sud. C'est ce qu'a fait Ellington toute sa vie, de mettre toute la vaisselle sur la table, même si son menu était par ailleurs très rigoureux : jus de pamplemousse, steak et salade. Un homme qui avait lu quatre fois la Bible en entier, qui avait pris un grand plaisir à converser avec la reine Elizabeth, qui avait peur d'être "empoisonné par l'air pur", et qui ne se déplaçait jamais sans sa trousse médicale portant l'inscription : "Dr E.K.E." (Docteur Edward Kennedy Ellington). En plein milieu d'une répétition, il pouvait réclamer à son médecin et ami Arthur Logan qu'il lui prenne le pouls. « On ne sait jamais comment on se porte avant d'avoir pris l'avis de son médecin. » Évidemment, la meilleure manière de savoir comment il se porte est encore pour Duke Ellington de mettre toute la vaisselle sur la table, en compagnie de ses musiciens.
lundi 3 mars 2014
Bruckner l'infâme piétiné par ses chevaux, même
Nous n'avons pas réussi à compter les notes que joue un musicien du pupitre des premiers violons dans la Septième de Bruckner. En revanche, nous sommes parvenus à le faire pour ce qui concerne le percussionniste. Il joue très exactement UNE (1) note, en plein milieu de l'œuvre. Une note en une heure et quart de musique, ce qui oblige le pauvre homme à assister à la totalité du concert. C'est scandaleux ! Il s'agit là d'un cas patent de perversion compositionnelle et d'indiscutable discrimination. On savait déjà que Bruckner était catholique, ce qui est très grave, mais voilà en plus qu'on vérifie que c'était un authentique nazi (il admirait beaucoup Wagner) qui n'a vécu que dans le but inavouable de préfigurer un certain Éric Zemour. Nous sommes heureux et fiers de dénoncer cet horrible personnage qui continue, dans certains cercles nauséabonds, de faire des ravages, avec sa musique patibulaire, que décrivait déjà si bien à l'époque un certain Eduard Hanslick : « Ses intentions poétiques furent, pour nous, tout sauf limpides—peut-être un peu comme si la Neuvième de Beethoven avait donné son amitié à la Walküre de Wagner pour finir piétinée par ses chevaux. » Tout sauf limpide ! Tout est là, en vérité. Cette musique est l'emblème scandaleux de tout ce que le passé a de trouble, de sombre, d'opaque, d'ambigu, de nauséabond, tout ce dont nous autres modernes nous sommes débarrassé avec le succès qu'on sait. Ne retombons pas dans les poussiéreuses ornières d'un Moyen Âge toujours avide de renaître de ses cendres. Il faut militer pour faire interdire la musique de Bruckner dans la République fronçaise. Les jeunes générations nous remercieront.
NB. Si vous connaissez des gens qui écoutent encore cette musique, faites-nous savoir à ce numéro vert : 09 87 65 43 21
NB. Si vous connaissez des gens qui écoutent encore cette musique, faites-nous savoir à ce numéro vert : 09 87 65 43 21
Cédric Karon
lundi 30 septembre 2013
Itinéraire d'un provincial
1, bis, place des Vosges, 4e
Rue de Charenton, 11e
Avenue du Bel-Air, 12e
10 (?), rue Ferdinand Duval, 4e
62, rue Joseph de Maistre, 18e
(Planay, Bourgogne)
56, rue Saint-Louis en l'Isle, 4e
2, rue des arquebusiers, 3e
3, place des Vosges, 4e
35 (?), rue de Seine, 6e
13, rue Linné, 5e
12 (?), rue Villehardouin, 3e
Rue de Lappe, 11e
35, rue Racine, 6e
dimanche 28 avril 2013
Picasso, son héros
C'est tout de même idiot ! Depuis qu'il m'a dit son amour pour Picasso, "le choc", j'ai tendance à moins aimer celui-ci, à lui trouver des défauts qu'il ne me serait jamais venu à l'idée de remarquer plus tôt, ni surtout de considérer comme tels. Comme il est peintre lui-même, "artiste-peintre", comme il dit, et que sa peinture est affreuse, enfin, non pas affreuse mais profondément ennuyeuse, sans aucun attrait pour moi, laborieuse au sens le plus décourageant qui soit, peinture de paysages à la touche épaisse et colorée de rythmes que je ne peux que qualifier de gras, non, lourds, je ne fais plus que remarquer des similitudes entre ceux-là et ceux qu'on trouve aussi dans la manière qu'a Picasso de passer d'une couleur à une autre.
Il ne faudrait jamais parler de musique ni de peinture avec personne, quand on a la prétention d'en "faire" soi-même.
J'entends Brendel qui joue la Sonate au clair de lune, via iTunes, sans que je lui aie rien demandé. Je ne sais pas si je l'aurais reconnu sans cela, mais je sais que c'est lui parce que, juste auparavant il a joué les Variations en fa mineur de Haydn, et encore avant le Concerto italien de Bach. Brendel, que je méprisais, il y a trente ans, parce qu'il jouait ce même concerto comme un grand pianiste…Brendel, dont le livre, lu à l'époque, Réflexions faites, si je me souviens bien du titre, ne m'avait pas convaincu. Il faudrait tout reprendre. Tout recommencer, depuis le début, ou presque, pour voir, pour comprendre où l'on s'est fourvoyé, quel était l'embranchement maudit, le détour de trop. Pourtant, Brendel dans le 20e concerto, c'est quelque chose, mais il y avait aussi cette élève qui ne jurait que par lui dans Schubert — et encore cette autre que j'avais emmenée écouter Pollini à Pleyel dans Brahms et qui avait fait la moue en me parlant d'Ashkenazy !
L'encadreur me présente le peintre, héros de la soirée, en le qualifiant — et il insiste, le bougre — de "laborieux" ! J'imagine qu'il veut dire par là que le peintre est un gros travailleur. Encore ne parle-t-il même pas de son art, à ce que je comprends un peu plus tard, mais des restaurations de maisons dont s'est occupé l'artiste pour gagner sa vie. On hésite : est-ce moins grave, ou plus ? L'artiste ne réagit pas. Soit il s'en fiche éperduement, soit il connaît le personnage, soit il ne comprend pas non plus de quoi l'autre parle, soit il pense déjà à ce qu'il va répondre à la prochaine personne qui tient absolument à lui être présentée, et qui lui parlera de "la sensualité de ses rouges".
La province, est-ce ce lieu où l'on rencontre des artistes-peintres laborieux et où le souvenir enchanté et vivifiant de la peinture de Picasso se met à décliner lentement ? Mais la province, ce sont aussi ces longs moments que l'on peut passer en compagnie des sonates en si de Berg et de Liszt, où l'on a assez de place pour disposer les partitions par terre, feuille à feuille, et les apprendre par cœur en posant ses pas par-dessus, depuis le salon jusqu'à la salle de bains, et où la jolie voisine qui va chercher le lait s'arrête en chemin et vous parle de "votre" étude en ut dièse mineur de Chopin qui lui semble bien meilleure depuis quelques jours. Elle n'aime pas du tout Picasso, mais elle a de très jolis seins. On lui composera un petit trio pour son ensemble, qui sait…
Tiens, Brendel se met à Berg.
lundi 23 avril 2012
lundi 1 septembre 2008
Le Cercle
Inscription à :
Articles (Atom)