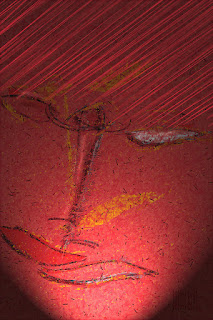Dans une petite ville française, à la fin des années soixante, il y avait toujours une belle fille et une fille à la moralité douteuse. Il pouvait arriver que ce soit la même mais c'était rare. Le garçon de douze ou treize ans, dans ces années-là, arpentait volontiers les rues de la ville à la recherche de l'une ou l'autre. Tous s'accordaient à nommer la première, et exprimaient la volonté farouche de la croiser, au moins une fois par jour. Il en allait bien autrement pour la seconde. Prononcer son nom avait le goût du péché.
Longtemps, j'ai eu son nom sur le bout de la langue. Plus je la voyais, poussant son landau entre l'église et la pharmacie – devant la devanture du coiffeur, à l'angle de la rue des Bugnons et de la rue Charles de Gaulle, près du cinéma (ça sentait le vin, par là, à cause de la proximité des caves Favre) –, moins je pouvais lui adjoindre un nom. Je savais que ce nom était constitué de deux syllabes et que l'une d'elles était vocalisée par le son "a", mais il m'était impossible de retrouver les consonnes qui jointaient tout ça. Ce qu'il reste des gens, longtemps après, ce sont les voyelles, les sons tenus, une note ou deux, et une image, ou moins qu'une image ; pas les consonnes, qui sont en dur, qui sont comme les coups qu'on reçoit dans les tibias. Enfin il me semble. Les coups dans les tibias on les oublie. Ça ne prend pas. Il y avait un pressing qui s'était installé là, en face de la poste. Un pressing, on ne savait même pas à quoi ça servait, à ce moment-là. Et en plus il était tenu par un Arménien.
Le goût des huîtres ne m'est venu que beaucoup plus tard, et je ne parle même pas des escargots. À Rumilly, entre midi et deux, je vous jure qu'il y avait une drôle d'ambiance. Ce n'était pas le Far West, non, c'était beaucoup mieux. S'aventurer là, entre la rue Frédéric Girod et le passage de la Visitation, ça nous donnait des vapeurs, d'autant plus que le père n'était pas loin, qu'il pouvait passer à tout moment, sans prévenir, car il n'avait pas d'horaires, mon père. « Ce qui est est, ce qui existe existe, et ce qui n'existe pas n'existe pas. » C'est Parménide qui a écrit ça. J'aurais aimé la trouver, celle-là. Tout ce que je suis capable de dire, moi, c'est que la fille Sassi a existé, que je n'ai jamais couché avec elle (Grand Dieu !), que je ne connais pas le goût de ses baisers, que je n'ai jamais vu ses nichons, et qu'il pleut au moment où j'écris ces lignes. Papa, est-ce que tu t'es douté de quelque chose ? C'est bien possible. Il était extra-lucide, mon père. Il savait tout, on ne pouvait rien lui cacher. Il ne montrait jamais rien et donc on se faisait toujours avoir. Longtemps après, très longtemps après sa mort, les langues ont commencé à se délier. On aurait dit que tout Rumilly voulait me parler de mon père. Les coiffeurs, les médecins, le marchand de chemises, le Receveur de la poste, le propriétaire du cinéma, le kiné, le plombier, le maire, tous ils avaient des histoires à me raconter. Je leur ai dit : Du calme, les gars, du calme ! On va procéder par ordre. Je ne peux pas tout entendre à la fois.
Tout ça pour dire que la fille Sassi est restée sur le bout de ma langue, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que j'ai retrouvé son nom, sans doute va-t-elle disparaître, et rejoindre les fantômes sur les épaules desquels j'ai grimpé pour apercevoir ce que je vois aujourd'hui, un jardin sous la pluie, au mois de mai. La vie n'est qu'une tautologie inimaginable ! Il faut beaucoup d'imagination pour ne pas imaginer la réalité. Pour voir ce que je vois, là, aujourd'hui, a-t-on besoin de vivre soixante ans, a-t-on besoin d'en passer par toutes ces journées affreuses ou magnifiques, par ces angoisses mortelles, par ces désirs lancinants, par ces échecs cuisants, par ces deuils, par ces douleurs indicibles ? La fille Sassi, on peut me dire que ce n'est rien du tout, juste une blonde quelconque, une de ces filles comme il en existe des milliers dans les villes et les villages de France, mais c'est justement parce qu'elle est quelconque qu'elle a pu venir jusqu'à aujourd'hui, qu'elle ne m'a jamais quitté, qu'elle a vécu sa vie souterraine en moi durant cinquante ans sans me donner la permission de la congédier, et qu'elle a installé en moi une structure et une vérité dont je ne me déferai jamais. Qu'y avait-il derrière les apparences de la fille Sassi ? Si je l'avais connue, si j'avais couché avec elle, ou même si j'avais été son ami, j'aurais eu l'impression de la connaître, de traverser ces apparences qui sont tout ce que je possède d'elle, mais je serais passé à côté de l'essentiel, et c'est l'essentiel de la fille Sassi qui revient aujourd'hui me hanter. L'essentiel de la fille Sassi, c'est cette image que j'ai sauvée de l'oubli. La fille Sassi n'est rien d'autre que cela, elle n'a pas d'épaisseur, c'est ce manque d'épaisseur qui l'a conservée intacte, simple comme une carte de visite oubliée, glissée dans la poche d'une veste qu'on ne met plus et qu'on retrouve des années après. « Mon âme, qui a glissé sur toutes les pentes, est déchirée et rapiécée comme un fond de vieille culotte » alors que celle de la fille Sassi est restée aussi lisse que son visage et que la peau de ses cuisses.
La fille Sassi aurait dû aller se faire voir ailleurs, dans le monde qui était le mien. C'est peut-être ce qui a précipité mon regard – l'ailleurs en lequel elle était tenue d'être vue et regardée, c'est ce lieu étrange où le désir prend naissance. Elle m'a littéralement dévoyé, perverti, et j'ai aimé cette sortie de route. La fille Sassi, pourtant, était bien réelle, et sans doute est-elle toujours vivante aujourd'hui. Elle serait surprise, je crois, que je parle d'elle en ces termes, que je lui consacre ces quelques heures et ces quelques paragraphes, elle qui vraisemblablement ne m'a même pas remarqué, alors. Des deux personnages du couple (la belle fille et la fille à la moralité douteuse), c'est elle qui aura eu le plus d'incidence sur ma vie.
Quand j'ai commencé à écrire ce texte, je croyais que j'allais être capable d'identifier, ou seulement d'approcher ce qui, chez cette femme, dans sa figure, dans son corps, était tellement "érotique", à mes yeux. J'ai échoué. Je ne peux que constater qu'elle a creusé en moi une cavité, une empreinte, un moule dans lequel toutes les filles que j'ai regardées et désirées dans ma vie sont passées à leur insu, et dans lequel elles ont peut-être ressenti furtivement une gêne presque imperceptible, celle qu'on éprouve quand la place qui nous a été attribuée n'est pas complètement à notre taille. D'ailleurs, le mot "érotisme", en l'occurrence, me met mal à l'aise ; il ne s'agit pas réellement de cela. La fille Sassi me troublait infiniment, ça c'est certain, mais est-ce qu'il est question ici d'érotisme ? Ou alors l'érotisme réside précisément dans cette sensation d'ailleurs irrémédiable, d'étrangeté radicale, comme lorsqu'on se trouve face à un cadavre, à un corps déserté par la vie ? Elle était bien vivante, bien en vie et bien en chair, la fille Sassi, mais elle avait l'air de vivre dans un monde parallèle, un monde dans lequel je ne pourrai jamais pénétrer, sauf à y laisser tout ce qui me constituait. Elle ne nous provoquait pas, je l'ai déjà dit, elle se contentait de passer, de pousser son landau dans les rues de la ville ; et pourtant, le seul fait qu'elle soit là, parmi nous, était une provocation. Peut-être parce que dans son sillage se mouvait un monde qui ne coïncidait pas avec le nôtre, et que ce monde-là créait une distorsion tout à fait perceptible dans notre réalité. C'était une intruse. Elle fracturait notre réalité, mais avec une grande placidité, sans ostentation, sans hystérie.
Les mots précieux se refusent à nous au moment où l'on écrit. Les femmes qui survivent au désir sont celles qui se refusent à nous au moment où l'écrit n'a pas encore commencé à redoubler notre vie, quand le récit n'est pas en mesure de se contrefaire lui-même, de se détacher de ce qui le suscite et le neutralise. La chose la plus difficile au monde est de voir ce qu'on a sous les yeux, la vie sans son double. Les femmes survivent au désir, les hommes non.