Elle est morte. J'ai écrit ces trois mots. J'en ai fait une phrase. L'impossible est là, sous mes yeux. L'invisible est visible. La mort n'est plus une chose abstraite, toujours à venir, impalpable, ce n'est plus une ombre furtive. C'est un corps. Un corps blanc, massif. Une sorte de statue. Je peux la toucher. C'est ça. C'est là.
À partir de maintenant, c'est comme ça. Le monde a changé. « Et tout à coup… » articulait mon père, dans le lit, le dimanche matin, lorsqu'il me lisait Babar. Tout à coup je comprends ce "et tout à coup !". Je l'entends, pour la première fois.
Quel est ton parfum, ô Mort ? Quelle est cette odeur qui a traversé les siècles, inaltérée, inaltérable ?
Quand j’allais chercher Christine à la gare de Lyon (elle arrivait d’Avignon), je la prenais immédiatement dans mes bras, à peine descendue du wagon, et nous nous embrassions longuement, très longuement, et quand le baiser cessait, souvent, nous étions seuls sur le quai, son train arrivait le soir, tard. Le voyage était long, en ce temps-là, il n’existait pas de trains à grande vitesse. Parfois, elle sentait le gaz. « Mon amour, tu sens le gaz. » Un gaz inerte, un gaz “sans odeur”… J’imagine que c’était la manière qu’avait son corps d’exprimer une certaine fatigue. Elle n’avait pas aimé que je le lui dise. D’ailleurs, quand je pense à Christine, dont j’ai aimé passionnément le corps, je m’aperçois qu’aucune odeur n’y est attachée, en dehors de cette odeur qui n’en est pas une. J’entends le “très calme” du premier mouvement de la sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc, avec ces arpèges ni rapides ni lents, qui montent et qui descendent, et je ne peux m’empêcher de respirer à leurs rythmes. Michel Portal avait croisé Christine dans la boulangerie qui était près de la maison de la radio : « Il n’a pas pu s’empêcher de me draguer. » Je ne savais pas si je devais être fier ou inquiet. Et puis Luc Ferrari et puis tant d’autres… Elle ne laissait personne indifférent. La plus belle lettre que j’ai jamais reçue est l’une des siennes, écrite d’une petite chambre, en Pologne, par temps de neige. Elle y était avec son amant, un Allemand. J’ai toujours la lettre, où elle me raconte sa nuit d’amour avec lui. « Romance. Très calme. » La clarinette. Jaruzelski. Solidarność. Neige. Désir.
Véronique avait des cuisses comme des poteaux télégraphiques. Marbre veiné. Elle faisait partie des danseuses de l'école de danse de Susan Buirge, à Genève, pour laquelle j'avais composé la musique du ballet de fin d'études. Elle habitait Gaillard, près de la frontière. J'en étais secrètement amoureux. Elles étaient presque toutes belles : entrer dans le vestiaire lorsqu'elles s'y déshabillaient en faisant comme si c’était naturel était l'un de ces moments qui marquent un homme. La désinvolture avec laquelle elles se promenaient nues, y compris devant un mâle, me semblait quelque chose d’irréel. Je me sentais Ulysse au pays des Nymphes, Ali Baba dans la caverne aux quarante voleuses. Calypso était grande, brune, bien plus jeune que Christine. Infiniment tentante. Basson/flûte, Véronique dont la santé éclatait de manière presque douloureuse. Lorsqu’on croise une beauté pareille, dans l’invraisemblable plénitude de sa jeune force, et qu’on la voit se déshabiller, avec ce naturel d’animal, presque de gibier (mais un gibier nullement effrayé (ce n’était pas Mélisande)), on ne peut être qu’égaré tant il paraît impossible ou au moins incompréhensible que tant d’éclat nous apparaisse sans qu’on l’ait le moins du monde mérité, ni même recherché. Quoi, les choses sont ainsi, visibles à l'œil nu ? Elles se donnent ? Babar se promène, très heureux, sur le dos de sa maman.
Je ne pourrai jamais la consoler. Jamais. La vieille dame espère le retour du petit Babar. Elle lui a donné son porte-monnaie, et beaucoup plus. Les animaux nous font du mal parce qu’ils nous pardonnent tout, sans que nous ayons besoin de les implorer, de nous trainer à leurs pieds. Ainsi les mères. C’est la grande différence avec les femmes. Je t'en veux de ne pas m'en avoir voulu, et d'avoir perdu la parole avant que d'avoir pu me dire que tu ne m'en voulais pas. Chaque rêve que je fais aujourd'hui est une balle tirée en plein cœur : le mien. Ta mort me tue. La mort me sauve de la vie.
Comment s'appelle cette dame qui tient sa sœur (ou sa cousine) par le téton, dans ce tableau célèbre et invraisemblable qui ornait un livre d'histoire qui se trouvait dans la chambre de mes frères ? J'en pinçais pour elle. Elle s'appelle Christine, et sa sœur se nomme Isabelle. Isabelle avait trois seins. Elle était un peu grosse, un peu courte, un peu disgracieuse, mais quand elle allait prendre sa douche dans la petite salle de bains de l'appartement de la rue Joseph de Maistre, j'étais troublé. Pas à cause de ce troisième mamelon mystérieux dont m'avait parlé son aînée, non, seulement parce que je la trouvais extrêmement désirable. Pas de désir sans inceste, même et surtout s'il est tenu en respect derrière la porte de la salle de bains.
Qui est Agnès ? D'où sort-elle, celle-là ? La tient-on par le bout du sein ? Par l'oreille ? Par le bout du nez ? Est-elle née du geste d'une vieille dame au bord d'une piscine ? Je me souviens de celle-ci, animatrice sur un réseau de Minitel rose. Draguer sur le Minitel commençait à m'ennuyer, aussi avais-je décidé de m'attaquer non pas aux clientes qui venaient là chercher un homme discret et disponible, mais à celles qui contrôlaient nos échanges. Il était assez facile de les provoquer afin qu'elles (ou ils) sortent de leur neutralité de principe, assez facile aussi de connaître leur sexe. Ensuite il fallait faire en sorte qu'on en vienne à l'oralité, puis au premier rendez-vous, etc. Agnès ne s'était pas dérobée, et l'on avait longuement parlé au téléphone avant de convenir d'une rencontre dans une brasserie située près de chez moi. Ce qui m'a tout de suite séduit chez elle était sa voix. En habitué de ce genre d'échanges, je savais comme la voix peut tromper, plusieurs désillusions cuisantes m'ayant éduqué sans ménagement. Pourtant je continuais de vouloir faire confiance à mon oreille qui cette fois-ci ne me trompa point. Cette jeune femme était exactement semblable à sa voix, si ces mots ont un sens. Feutrée mais précise, lentement sinueuse mais d'une fraîcheur soyeuse, sa voix se tenait sans arrêt sur une crête de chaque côté de laquelle le grave et l'aigu restaient sagement tapis, sans que jamais l'un ou l'autre territoire ne vienne donner une couleur prédominante à l'organe d'Agnès. Même la légère nasalité qui était déjà à cette époque la caractéristique principale d'une tranche d'âge s'étendant de dix-sept à trente ans n'ôtait rien à la délicate sensualité un rien masculine qui émanait de cette jolie provinciale qui avait encore du mal à trouver sa place à Paris. Très peu maquillée, elle portait des manchettes et un col blancs qui dépassaient d'un pull mauve et me regardait avec une sorte d'incrédulité lasse. Elle insista pour boire de la bière à la place du vin que j'avais choisi. Lorsque quelques heures plus tard nous arrivâmes chez moi, elle me demanda d'éteindre la lumière et de caresser longuement, très longuement, la pointe de ses seins à travers ses vêtements, avant de consentir à se déshabiller. Sentir sous mes doigts les tétons durcis d'une jeune fille dont je n'avais jamais vu le corps me rendit fou de désir.
Anges-Senga-Agnès, les jeux anagrammatiques sont courants sur les réseaux où fleurissent les pseudonymes, et j'avais été fier d'avoir découvert l'identité d'Agnès à travers les divers masques qu'elle prenait tour à tour sur le Réso, puisque tel était le nom de l'endroit où elle travaillait. J'ai connu trois Agnès. La première est une cousine germaine perdue de vue depuis longtemps, je viens de décrire la deuxième, et la troisième était secrétaire au sein du conservatoire dans lequel j'ai enseigné durant quelques années. Sur ces trois Agnès, je me dis qu'il est fort probable qu'au moins une des trois est morte, et encore assez plausible qu'une deuxième soit gravement malade, sans doute d'un cancer. À moins que ce ne soit Véronique qui soit à l'agonie dans quelque hôpital de banlieue. Plus ceux que nous croisons sont vivants, bien vivants, au mieux de leur forme, à l'apogée de leur vitalité, plus la pourriture qui grouille sourdement à l'intérieur de leur être est vivace, prête à prendre le dessus, en un clignement d'œil. On s'extasie sur l'arrogance d'un mamelon, sur la puissance du désir de celle-là qui semblait si timide, si éperdue, et, au moment où nous portons la main sur sa chair incandescente, la transparence diaphane de son épiderme laiteux nous laisse pressentir la catastrophe déjà commencée, dans le silence effroyable du temps. On connaît la partition mais on refuse de l'interpréter. Les anges ont des faces de démons, dès qu'ils entr'ouvrent pour nous la porte de la durée.
Je suis obsédé par cette idée depuis quelque temps : quand ma chienne mourra, il faudra que je ne lui survive pas. Ce serait trop ignoble. Mais ne l'est-ce pas encore plus d'écrire cela, car je sais bien que je n'irai pas me laisser mourir sur sa tombe… Quand je rêve, et je rêve énormément, j'essaie toujours de franchir la barrière qui sépare les rêves humains des rêves animaux. Avant de m'endormir, je demande à ma chienne de m'emmener avec elle, mais je ne lui fais pas cette demande sans effroi, car il me semble comprendre depuis peu que la mort n'est qu'une plongée infinie dans un rêve dont on ne se réveille pas. Si je franchis la barrière qui nous distinguent des bêtes, fût-ce en rêve, il me semble évident que ma mort sera celle qui leur échoit. La décision n'est donc pas anodine. Je sais qu'elle m'aime, mais ses frères les chiens m'aimeront-ils aussi facilement ?
La première chose que fait un homme qui vient à la vie est de mentir, son premier cri est le signal, et toute sa vie ne sera qu'un long et fastidieux mensonge. Les plus menteurs sont ceux qui prétendent dire la vérité, bien sûr. La malédiction des chiens est l'absence de parole, celle des hommes est la parole. Dès qu'on ouvre la bouche, dès qu'on couche trois mots sur une feuille de papier, on ment. Notre Dieu est terrible ! Les musiciens sont les seuls humains qui ne supportent pas d'être condamnés à mentir. La musique est la tentative désespérée que les hommes ont imaginée pour sortir du règne infernal du mensonge. Quand j'allais me confesser, enfant, je ne savais jamais quoi dire, je ne distinguais pas bien les péchés des non-péchés, mais, instinctivement, je m'accusais de mensonge, certain là au moins de ne pas me tromper.
Sur le même Réso, j'avais rencontré Malika, qui s'y faisait appeler Ambre, entres autres pseudonymes que j'ai oubliés (ah si, je me rappelle "Nuages"). Ambre lui allait bien. Malika m'a fait découvrir l'amour acousmatique. Elle m'appelait au milieu de la nuit et chuchotait au téléphone : "Ne raccroche pas !" Je savais ce que cela signifiait : quelques secondes après, je pouvais l'entendre faire l'amour, pour moi, elle à Marseille, moi à Paris, dans la minuscule chambre de bonne que j'habitais alors, rue de Seine. Quand elle avait fini, elle raccrochait, sans un mot, et je me rendormais. Vous voulez entendre la voix d'Ambre ? C'est simple : écoutez le fa grave longuement tenu d'Helen Merrill dans son enregistrement de Don't Explain, avec Gil Evans et Clifford Brown.
J'ai oublié une Agnès, la dernière. Une belle et grande brune qui aurait pu devenir ma belle-sœur. Comme toutes les belles-sœurs, elle tient un blog où elle parle de sa vie, de ses enfants, où elle montre les photos qu'elle prend en vacances. Elle nous parle de ses problèmes de cuisine, d'ameublement, des maladies des petits, de ses beaux-parents. Parfois on voit son mari, qui a toujours l'air ridicule sur les photos, mais il faut tout de même le montrer, car c'est grâce à lui qu'on a une belle cuisine, une belle maison, qu'on vit à l'autre bout du monde, là où il fait toujours beau. Les babouines montrent leur babouin, pour éloigner les autres babouines, et indiquer "dans quel monde elles évoluent". Il fait beau, il fait bleu, il fait soleil, il fait grand, de l'autre côté du monde, et l'on y porte des lunettes de soleil, qui semblent avoir été greffées sur le crâne des belles brunes en pleine santé qu'on y trouve sur le sable. Agnès a de beaux seins bien fermes qu'on a disposé harmonieusement sur son corps de rêve. Elle habite au pays de l'Immortalité, que visitent parfois ses beaux-parents fiers de leurs petits enfants. Agnès-la-quatrième me fait penser à Anne-Sophie que j'avais vexée mortellement en lui disant dans un moment de colère qu'elle n'avait que des problèmes électro-ménagers. J'exagère toujours, elle avait des problèmes électro-ménagers et des problèmes de constipation.
Le lien est tellement devenu social, le social est tellement lié au lien, dans le grand dictionnaire contemporain des idées reçues, qu'on se demande avec quoi s'attachent les pauvres adeptes du bondage, de nos jours. Essayez donc d'attacher votre copine, si vos lubies érotiques font des nœuds, et vous l'entendrez vous tenir un discours social, sinon syndical. C'est un peu comme l'ascenseur. Un ascenseur qui n'est pas en panne est suspect, un lien qui n'est pas social n'existe tout simplement pas. Ce qu'il faut, c'est un lien social dans un ascenseur en panne. C'est ce qui nous a donné, Sarah et moi, l'idée d'expérimenter les ascenseurs. Ma légère claustrophobie ajoutait un peu de piment à l'affaire. Les femmes sont sensibles non seulement à la qualité des appareils ménagers, mais aussi au confort des moyens de transports.
Elle conduit. On la voit de profil, elle est filmée depuis la place du mort. Elle est concentrée sur la route, il pleut, elle roule à une centaine de kilomètres à l'heure. Monotonie de son profil. Les yeux, le nez, la bouche, et le paysage qui défile. Les joues un peu rosées. On entend une chanson à la radio. J'aime son nez. Elle regarde dans son rétroviseur. Cligne des yeux. Sa bouche s'entr'ouvre légèrement. Sa main droite quitte le volant, descend en direction du levier de vitesses. Elle ferme les yeux un bref instant. Un message publicitaire. La bouche s'ouvre à nouveau, lentement, les paupières se font lourdes. Elle tire sur les commissures de ses lèvres et souffle un peu. On comprend qu'elle est en train de se masturber. Les jolies dents. Elle met son clignotant. On entend un long coup de klaxon et on voit une voiture qui la dépasse en trombe, phares allumés.
Une des dernières haltes sur l'autoroute en revenant d'Alsace. Après avoir pris de l'essence, elle a voulu absolument faire l'amour là, dans le parking, dans l'Espace, alors que les voitures se touchaient, c'était la tombée de la nuit, et que des enfants jouaient à un mètre de nous à l'extérieur. Alors je l'aie vue recouvrir les vitres avec des cartes routières ; j'étais persuadé qu'elles allaient tomber, mais rien n'y faisait, elle se moquait de ma vergogne, elle n'a pas été satisfaite tant que je n'ai pas joui en elle.
« Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont lesbiennes. » Ah bon ? Il y a tellement de choses que j'ignore ! « Sais-tu que je n'ai pas lu le Discours de la méthode ? » Comment s'appelait-elle, cette longue jeune fille toute en tresses qu'on avait fourrée dans mon lit ? Toute une nuit à se demander si nos cuisses se frôlent — ou bien ai-je rêvé ? Au matin, épuisés tous les deux par une nuit sans sommeil, nous nous sommes embrassés sur les joues, et nous avons bu un chocolat chaud accompagné de brioches. Quel âge avions-nous ? Quinze ans ? Un appartement sur les quais du vieux canal, à Annecy. Il pleut. Peu de temps après, le professeur de dessin du lycée. Étrange femme très fardée, habillée de laines multicolores. Elle nous regardait, au bistrot, où nous avions nos habitudes, elle me regardait. Seule à sa table, elle aussi buvait des chocolats chauds. Elle m'entend dire que je cherche une chambre, que je veux "partir de chez moi". « Ça tombe bien, nous louons une chambre au château ! » C'est décidé, je la prends. Ma tante est chez nous, à ce moment-là, elle fait une scène à ma mère : « C'est encore un enfant ! » Ma mère soutient que non. « Et mêle-toi de tes oignons ! » Il fait très beau.
Elle ne veut pas me dire s'il la fait jouir. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein ! C'était pourtant l'occasion de confronter ma thèse du pot de confiture à un cas concret. Vous savez, le matin, au petit déjeuner, on demande au mâle d'ouvrir un pot de confiture récalcitrant. Il s'échine un bon moment sur ce fichu couvercle, qui lui résiste. À bout de force, les jointures des doigts blanchies, il repose le pot sur la table en décrétant qu'il est impossible à ouvrir par des moyens normaux. À ce moment-là, sa femme le saisit, et, apparemment sans le moindre effort, réussit à l'ouvrir. Ce qui s'est passé est que c'est lui qui a fait tout le travail, et que sa femme n'a fait que donner le dernier petit tour de vis, celui juste avant lequel il a arrêté son effort. Ce dernier petit geste n'était rien du tout mais il a eu un grand effet. Avec une femme frigide c'est la même chose : vous vous acharnez pendant des mois, pendant des années, à essayer de la faire jouir, et rien, ou presque. Le type qui arrive après vous n'a qu'à donner un dernier petit coup de poignet et le fruit tombe, bien mûr. Si ça n'est pas une preuve irréfutable de l'humour de celui qui a conçu les mécanismes humains et qui a ordonné notre présence dans cette vallée de larmes, je veux bien être pendu.
Nous rêvons toujours d'être quelqu'un d'autre. Une nostalgie est inscrite en nous dès l'origine qui nous rappelle que nous aurions pu être cet autre, que peut-être c'est encore possible. La plus puissante des nostalgies est celle qui nous prend face à l'être aimé, quand nous constatons qu'il manque à la scène que nous sommes en train de vivre. En face de nous, il est pourtant absent. Il ne nous offre que le creux que son corps fait dans la présence des deux êtres qui sont face à face. Beaucoup de scènes de ménage très violentes ont pour origine cette sensation insupportable de l'absence de qui nous côtoie. Impardonnable traîtrise. Nous ne savons ni qui nous voudrions être ni qui se trouve là en face de nous. En somme ce sont deux absences qui se font face. C'est un rond-point dépourvu de sortie. On est entré dans le cercle et la porte s'est refermée sans bruit.
Au Château, je lui faisais l'amour dans la chambre, pendant que le mari peignait dans la pièce d'à côté. Je ne prenais pas vraiment de plaisir avec Tara parce qu'elle était très brutale et que j'étais toujours plus ou moins sur mes gardes. Les griffures, les coups, les gifles, les morsures jusqu'au sang pouvaient arriver à tout moment. Elle était très démonstrative et le niveau sonore de nos ébats tel que nous n'entendions que par instants le mari en train de siffloter dans la pièce d'à côté. Il est entré brutalement dans la chambre, le visage un peu rouge, un chiffon à la main, en nous disant que ses parents étaient à la porte et que je devais déguerpir au plus vite. Je me suis retrouvé sur le palier en slip, mes vêtements à la main, leur appartement ayant plusieurs portes d'entrée, nous nous étions croisés, les beaux parents et moi, comme sur une scène de théâtre.
À cette époque là, je ne connaissais pas Hermann Scherchen, théoricien et chef d'orchestre allemand, proche d'Arnold Schönberg. D'ailleurs je n'avais jamais entendu parler non plus, ou très peu, de Schönberg, mais j'avais installé mes deux magnétophones Revox dans une des deux pièces que je louais au Château. Le Revox a été l'un des instruments les plus précieux de mon adolescence. Nous étions au printemps, et, par la fenêtre ouverte, j'entendais une fracassante troisième symphonie de Beethoven qui provenait du deuxième étage. J'avais déménagé tous mes instruments sauf le piano, et installé les micros de telle manière qu'il me suffisait de presser deux touches pour commencer à enregistrer. Michel était venu m'apporter une paire d'enceintes. Je le vois descendre de sa voiture, et je l'entends me dire : « Ça sent le foutre, ici ! » (Je ne connaissais pas le mot.) Si vous ne connaissez pas l'Héroïque par Scherchen, vous ne connaissez pas l'Héroïque. Quand j'entends les cors dans le scherzo de l'Héroïque de Scherchen, j'entends Christine qui dit d'une voix rauque : « Encore ! Encore ! » Je dors dans la salle de répétitions au rez-de-chaussée de la ferme que nous habitons en communauté avec les autres membres du groupe de jazz dont je suis le pianiste. Bientôt, je l'entends qui s'apprête à descendre, dans le noir, par la trappe pratiquée dans le plancher de sa chambre. Elle prend l'échelle, elle est nue, je devine son corps plus que je ne le vois, elle passe à quelques centimètres de moi, qui fais semblant de dormir, le cœur battant à tout rompre. Elle sort et va pisser dehors. Je ne le sais pas encore mais toute ma vie va être conditionnée par ces quelques moments inoubliables. Cette femme nue, invisible, dont le corps troue la nuit profonde, dont je n'entends que la voix au moment où elle jouit, je ne peux même pas dire que j'en suis tombé amoureux, car je ne savais pas ce que signifiait, ce que pouvait signifier ces quelques mots, tomber amoureux, mais être fou de désir pour un corps, ça j'ai compris tout de suite ce que ça signifiait. Elle bramait comme un cerf en rut et c'était la plus belle musique que je pouvais imaginer. Toutes les nuits, cette déesse sauvage descendait de son lupanar et me frôlait, la chair encore humide, odorante, creusée par le plaisir, et allait offrir son urine fumante à la nuit. De la tête aux pieds, elle est faite pour l'amour…
« Tu as raison de vouloir rester l'ami de ma sœur, elle a plus d'argent que moi. » Ah les merveilleuses familles ! Glenn Gould joue la 24e sonate en fa dièse majeur, de Beethoven, "À Thérèse". Thérèse-Marie, pour être plus exact. Altiste. Joli profil un peu triste. Une étrange manière de tenir sa cigarette, un peu à la Houellebecq. Nous faisait beaucoup rire quand elle imitait (très bien) l'accent de sa Picardie natale. Musicienne (au sens de bonne musicienne) mais altiste médiocre. Déjà que les altistes ont très mauvaise réputation parmi les musiciens… Je sais, la chose a un peu changé. Mince, fragile, le genre porcelaine qu'on a toujours peur de laisser tomber. Cherchait le grand amour, mal tombée avec moi, surtout en ce temps-là où j'avais un béguin prononcé pour Céline, très jeune fille rencontrée chez ma meilleure amie, en Bourgogne, dans la cuisine de laquelle je n'avais d'abord vu que sa chevelure, assez fournie, et son dos. J'ai immédiatement compris qu'elle me plaisait, sans même avoir vu son visage. Je ne sais toujours pas pourquoi. Sa voix ? Sa présence ? Le fait qu'elle ne se soit pas retournée sur moi ? J'ai aimé ce prénom, clin de ciel en cerne bruni, ce silence, cette timidité et ces allures d'adolescente indolente, cette gentillesse non calculée, cette confiance sans limite. Céline était à la fois scarlatienne et scriabinienne. Long corps un peu rugueux en mi majeur. De beaux seins. Un grand nez. Infiniment douée pour le dessin, des mains aux doigts très fins que j'aimais regarder autour de ma queue. Elle mettait son nez près de mon sexe et me demandait quel appendice était le plus monstrueux…
Les quelques mois passés auprès de Céline ont été un enchantement. J'approchais de la trentaine, elle avait quinze ans et demie lorsque je l'ai rencontrée et nous avions le même âge, toujours pouffant de rire et sérieux comme des papes, tout le monde l'aimait, personne ne comprenait. Quand on aime une très jeune fille, on s'imagine toujours que cet amour-là possède une qualité rare, qui est d'abolir les rapports de force dans le couple que nous formons avec elle. Le rapport de force est tellement central, tellement à sens unique, tellement sans autre, qu'on ne le voit pas, qu'on ne peut même pas l'imaginer. C'est une chose qu'on paye ensuite très cher, mais ce prix n'est rien du tout en comparaison d'un bonheur comme celui-là. J'avais passé dix années avec Christine, dix années de guerre violente, exténuante, intense, dix années de plaisir et dix années de malheur, nous faisions l'amour comme des bêtes furieuses, elle me trompait, je la trompais, je l'aimais, elle m'aimait, elle m'a tout appris, je lui ai tout pris, nous avons tout appris ensemble, nous avons eu faim ensemble, froid aussi, nous nous étions quittés dix fois, retrouvés cent fois, à peine l'avais-je quittée pour trois jours que je me branlais dans la voiture entre la gare et mon domicile en pensant à son corps, je l'ai partagée, je me suis battu pour elle, j'ai voulu mourir pour elle, je l'ai haïe, et je l'ai quittée. Je l'ai quittée non pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que je l'aimais trop, et parce que Céline me promettait un amour simple, facile, rapide, léger, un amour à l'intérieur duquel j'étais le maître, où personne ne discutait mes désirs, j'ai quitté Christine pour connaître moi aussi les plaisirs qu'avaient connus nos grands-parents, pour être enfin, mais pour très peu de temps, un homme. Les infinies négociations inhérentes au couple, le côté syndical de la relation amoureuse, j'en avais ma claque, je voulais me mettre à mon compte.
Un épisode me revient, à la fois drôle et dramatique, un épisode survenu un soir d'hiver que j'étais sorti avec une pianiste américaine. Quand je suis rentré à la maison, au milieu de la nuit, j'ai trouvé une veste à moi, une veste que j'aimais beaucoup, découpée en petits morceaux, sur le tapis du salon. La paire de ciseaux était sur le tas de tissus, au cas où l'on ait pu penser qu'il n'y avait là aucune intervention humaine, peut-être, je ne sais pas au juste ce que cette paire de ciseaux sur les carrés de tissus était censée signifier, ou prouver. On peut rire, bien entendu, on peut trouver la chose ridicule au dernier degré, et il me semble bien me rappeler d'ailleurs que j'ai dû réprimer un fou-rire, quand je me suis trouvé face à ma furibonde Pénélope-aux-ciseaux. N'empêche, il a bien fallu s'engueuler violemment pour atténuer le côté farce de la chose. Tout plutôt que de rire ! Il est possible après tout que je sois passé ce soir-là près de la mort. C'était peut-être le sens de la paire de ciseaux restée en évidence sur les restes du carnage : farce ou tragédie, tu dois choisir ! Mais je n'étais pas un homme. J'étais un enfant au sein, à son sein. Christine me nourrissait encore. M'aurait-elle planté ces ciseaux dans le cœur qu'elle aurait tué l'enfant qui ne lui en avait pas encore fait un. Deux enfants morts d'un coup, nous n'avions en ce temps-là ni l'ambition ni le sens de la tragédie qui convenaient. Ce qui est certain est que ces violentes disputes étaient toujours l'occasion pour nous de faire l'amour de manière encore plus intense, juste après, ce que Christine me reprochait comme un manque d'originalité flagrant. Je crains de devoir avouer que dans le domaine de la sexualité je n'ai strictement aucune originalité : j'aime les belles femmes avec des beaux derrières et des beaux seins, ces femmes dont le corps est en lui-même le supplice atroce qu'elles nous mettent sous les yeux jour après jour en faisant semblant de ne pas s'en rendre compte : j'aime les salopes qui ressemblent à des femmes. Elle avait d'ailleurs les mêmes goûts que moi.
Je savoure l'absence totale d'aventures dans ma vie présente. Non seulement il ne m'arrive rien mais surtout je n'ai aucune envie qu'il m'arrive quelque chose. Ma mère me disait quelquefois son idée du bonheur, ou plutôt faudrait-il l'appeler son souvenir du bonheur. C'est le soir, au village, en Corse, en été, ou peut-être au printemps, la nuit va bientôt tomber. Elle est allongée sur un banc, la tête sur les cuisses de son père qui se tient là, assis, immobile. On entend seulement les passants. Leurs pas, et aussi les rares paroles qu'ils échangent entre eux : « Bona sera. » Elle regarde le ciel et elle entend, à intervalles réguliers, ces "bona sera" qui la bercent, la rassurent, l'immergent dans un fluide doux et paisible. On parle bas. On ne dit rien. On se tient là, dans le temps qui prend corps, ensemble. Et c'est tout. Et c'est assez. Rien n'est de trop, justement. Personne ne crie, personne n'élève la voix. C'est tout juste si l'on se sent vivant, et c'est de cette manière qu'on se sent pleinement vivant, sans détour, dans la sérénité, dans la paix du cœur. Rien ne nous attend ailleurs. L'air est doux, il sent bon, aucun bruit de moteur, aucune radio tonitruante, aucune télévision, aucune mobylette, pas de klaxon, et, je le redis parce que c'est essentiel : personne n'élève la voix. Bona sera… Ce rythme, ces voyelles, ces deux accents légers, cette brièveté ; rien n'est appuyé. Peut-être qu'à l'autre bout de la place une femme fredonne une chanson, mais ce sera sotto voce, pour elle-même.
Le ciel est bleu, intensément bleu. Trombones droits plus une caisse-claire sans timbre. Pierre et le loup, Delphine et Marinette, c'est la même porte qui donne sur le jardin, avec le petit escalier. Cette petite pièce tout en longueur avec son petit évier métallique entre la cuisine et le jardin que nous avons nommée "la loggia", sorte de sas par lequel il faut passer pour aller du dedans vers le dehors. Elle donne à toute la maison son caractère, sa lumière, en tout cas dans mon souvenir. Les chats y dorment parfois. Y naissent, quand ce n'est pas dans le placard de la cuisine. Rideau de cordes, ondulation régulière et calme, tout va bien. Babar, Tintin, Prokofiev, Marcel Aymé, le loup au fond du jardin, derrière le mur où se trouvent les pommiers, la pelouse où l'on joue au croquet, le jardin qu'on voit depuis la fenêtre de la cuisine, comme si l'on était au théâtre, le jardin où s'ébat le chat de Delphine et Marinette et celui d'Alice, le jardin avec ses deux grandes cabanes en bois, avec les clapiers, avec les recoins sombres, la grande verrière qui m'évoque toujours Mathilde Wesendonck et Richard Wagner, Agnès Mathilde Wesendonck, la femme d'un autre, le désir personnifié, le mensonge, la dissimulation, le trouble, la maison, la famille, les couples, les chuchotements, le froissement des robes, les déjeuners interminables et ce qui se passe sous la table, les rougeurs subites, les phrases qu'on ne comprend pas, les regards, les silences coupants, les phrases laissées en suspens, les phrases sur d'autres phrases, la morsure et l'ombre du père qui fait taire tout le monde, les asperges, le foie gras, le grand buffet avec ses tiroirs que je fouille régulièrement, j'y ai trouvé un revolver, des cigares, et même de l'argent, les albums de photos, les symphonies de Brahms dans l'armoise bressanne, les violons sur la bibliothèque, l'étui noir, l'étui brun, la musique viennoise, et les deux portraits de Mozart et Beethoven, les dieux, au-dessus du piano, c'est tellement grand, une maison où l'on est né… « Il n’y a pas de chagrins d’amour, excepté dans cette phrase qui pour les nier contre toute évidence se voit bien obligée de les nommer encore. »
Ce matin, le ciel est encore rose, il n’y a aucun bruit, c’est le moment que je préfère. J’y vois à peine assez pour écrire : les mots ont du mal à émerger du cahier, et j’entends le crissement du stylo sur le papier, et le bruit de mon bras qui se déplace sur la page. Par la fenêtre, je vois les mêmes montagnes que celles que je voyais, enfant, de ma chambre, quand j’étais malade et que je passais de longues heures à rêver, ou à regarder Abdou, le chat noir angora, qui jouait dans la neige. Ses sauts brusques, comme des caractères d’encre qui s’écrivent et s’effacent du même pas. Je me lève pour aller mettre ton disque. « J’envie ton vin parmi les fleurs, les papillons que ton rêve déploie. » Je me rassois, je t’écris. Mes yeux s’appesantissent. Je suis l’égarement qui se lève en moi, je pose un regard sur cette clarté trouble du jour qui vient. Blanc, rose, bleu, or, le givre des muqueuses cuivrées, comme si une bouche s’ouvrait dans le ciel, rosée de paroles…
Je recopie cette phrase : « Elle se souvint soudain de son enfant mort et une vague de bonheur l'inonda. » Et cette autre : « Contre les sentiments personne ne peut rien, ils sont là et ils échappent à toute censure. »
J'entends sa voix. Roses du sud… « Est-ce que tu m'aimes ? » J'entends ma voix, de l'extérieur, cette voix que je déteste. Je me vois, en tenue de premier communiant, au bas des marches, dans le jardin, avec ces grosses joues et cette peau grasse d'adolescent. Je déchire la photographie. Applaudissements. Je détache son soutien-gorge, blanc, un peu sale, elle refuse que j'ôte sa culotte, l'odeur de ses seins, un peu plats (je suis déçu), ordinaires, nous sommes couchés près de la mobylette sur laquelle je l'ai amenée ici, près de la rivière. Elle ne me sourit pas, pas du tout. Tout cela ressemble à une corvée. Je dois la déshabiller, il faut que je le fasse. Son visage maussade, inoubliable. Elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Pourquoi est-elle venue, pourquoi ai-je insisté ? Amants par défaut, sans doute, nous nous sommes rabattus elle et moi sur ce qui restait. Elle n'a pas de nom. Chantal ? Martine ? Laurence ? Christiane ? Marie-Jo ? Nicole ? Elle mâche un chewing-gum. Elle ne parle pas. Repousse seulement ma main qui descend vers sa culotte. On rentre. C'est fait. Rien.
À 8000 mètres d'altitude, sans oxygène. Deux fois de suite dans le même mois. Elle parle du son de la voix, là-haut. Le matin où la mère de Chantal Mauduit est morte, celle-ci se réjouissait que celle-là soit enfin rentrée à la maison, la veille. Quand elle est partie au lycée, au matin, personne ne lui a dit que sa mère était morte. Chantal éclatait de rire à tout propos, ce qui avait le don d'exaspérer ses camarades de classe, et ce jour-là son rire et son sourire ont disparu radicalement. Il a fallu l'Himalaya et "le pays du sourire" pour qu'elle retrouve son rire, ses fous-rires, cette espèce d'ivresse perpétuelle qui la maintenait en vie, à côté des autres, mais pas réellement avec. Il a fallu cette absence d'air pour qu'elle retrouve son souffle. Pourquoi partait-elle seule, là-haut, si ce n'est pour y retrouver la disparue, hors le monde ? Nuages, les Nocturnes de Debussy au crépuscule, lorsqu'on a quitté le monde des hommes, et que l'impossibilité de partager cette beauté sublime oppresse, pèse, rend le corps trop lourd au lieu de l'alléger. Les pizzicatos de la harpe avec la flûte, étincelles dans la poitrine, le temps crépitant ; et le serpent lancinant du cor anglais, qui vient, revient, la douleur humaine dont on ne se débarrasse jamais, ces quatre notes montantes puis ces quatre notes descendantes, retour, encore, impossible d'échapper à ce retour en soi, contre soi, dans les viscères, alors qu'on est allé si loin, qu'on est à la frontière du monde. Le fil est si tendu alors, si mince ce qui nous retient… Lisière, transparence de l'être qui se dilue, limite, crête, exténuation, je suis certain que Chantal a voulu connaître ces états ultimes, qu'elle les a connus, fugue furtive, comme une naissance à l'envers, on retourne en la mère en rompant le cordon qui nous lie aux vivants. Le son de la voix qui se transforme ? Les voix entendues depuis le ventre de la mère. Éternel retour à l'envoyeuse. La mort comme une fatigue soudaine, lassitude infinie, à quinze ans, à trente-quatre ans, à quoi bon faire le chemin quand on a compris qu'il faudra revenir à la source en laissant tout derrière soi. Pourquoi ne pas rire à nouveau, mais d'un rire nouveau, un peu fou, un peu perdu, éperdu, un rire étouffé de neige, un rire d'absolue solitude. Voile qui sépare la mort de la vie, seuil linceul, nuages dans le cœur, souffle au ventre, soleil froid : Dhaulagiri Debussy.
Travailler la Sonate de Liszt, la Chaconne de Bach-Busoni, la quatrième Ballade de Chopin, l'opus 27 de Webern, les Diabelli, la sonate en si bémol de Schubert, la Sequenza de Bério, la suite opus 25 de Schönberg, la Fantaisie de Schumann, la sixième de Scriabine, les Ballades de Brahms, c'est inouï le plaisir qu'on prend à passer des heures et des heures avec ça, seul avec ça. (Ce plaisir solitaire est sans doute ce qui séparera toujours les musiciens du reste de l'humanité, et c'est particulièrement vrai quand on est pianiste.) Mais il est un plaisir encore plus intense, plus profond, vraiment spécial… Les fugues. Passer du temps (mais ce n'est pas "passer du temps", c'est être le Temps) avec les quatre ou cinq ou six voix d'une fugue de Bach, se mettre à l'intérieur de chacune d'entre elles, ne jamais les lâcher, dans ce dialogue (mais ce mot ne convient pas, précisément…) sur-humain, infra-humain, métaphysique, de voix qui peuvent parler ensemble sans s'écraser, sans s'intimider, sans… Je ne sais pas comment ça fonctionne mais c'est ce que cherche l'humanité depuis toujours, c'est ce qu'elle ne trouvera jamais dans ce monde-ci. Il me semble qu'un enfant, sans le savoir, se met à la musique pour ces raisons-là, parce qu'il sent qu'il manque quelque chose au monde (c'est à ce moment-là que cette certitude est la plus forte). La vraie musique est la tentative d'inscrire ses pas dans un chemin qui rend au monde sa part manquante, sa face silencieuse. Il faut une discipline de fer pour passer de l'autre côté des apparences, pour respirer l'air des cimes, pour entendre le chant de la Terre, et le contrepoint est la forme qu'a prise la connaissance la plus efficace, la plus puissante qu'ait inventée l'homme pour accéder à cette réalité plus réelle que la rumeur déformée et appauvrie qui nous en parvient habituellement. On n'entre pas dans une fugue comme on entre dans une sonate, comme on entre dans une série de variations, une suite de danses. Dans toutes les formes musicales, on ajoute, on construit, on bâtit, on édifie, on dessine, on peint, on portraiture, on dispose des couleurs, des formes, des transitions, des cadences, on meuble une demeure, on décore un espace, on délimite une propriété, un territoire, on est chez soi, on emménage, on aménage. La fugue n'est pas un lieu, elle ne nous appartient pas, on ne peut pas y vivre, y rêver, s'y promener à sa guise, on n'en dispose pas, vous n'êtes que le fugitif locataire. Comme le temps, elle échappe aux mains humaines, et même à sa pensée, on ne peut qu'en suivre un instant le cours, parcourir grâce à ses voies un monde qui n'est pas nôtre, éprouver à travers ses voix une Joie inconnue (celle de la Connaissance) qui nous fait trembler d'effroi. Le compositeur qui écrit une fugue ne décide pas, il se plie à la matière, il la respecte, il l'écoute, tente d'aller aussi loin que possible grâce à elle, comme ces sorciers yakis qui par le truchement d'un animal volent ou se déplacent en un clin d'œil à des centaines de kilomètres, qui sentent ce qu'il sent, entendent ce qu'il entend, voient ce qu'il voit, comprennent ce qu'il comprend. Ça ne dure pas, c'est éphémère, furtif, mais d'une puissance phénoménale. Personne ne peut le décrire, ne peut raconter, et personne ne vous croira, de toute manière, si vous tentez d'en parler. L'écrit-il, seulement, cette fugue, son auteur ? Il écoute un récit, plutôt, parlé en une langue étrangère, c'est une sorte d'espéranto impossible, mais langue maternelle tout de même : on la comprend mais on ne la prend pas, elle ne prend pas, c'est le vivant qui se donne à entendre, dans sa vérité irréductible, intraduisible : on entend, tout à coup, il n'y a rien d'autre à dire. C'est la Joie du Mandarin de cuivre. Jean-Sébastien Bach y perdit ses yeux, à suivre ces chemins jusqu'à leurs cimes sans oxygène, comme Chantal Mauduit revint aveugle du K2. Il a voulu connaître le pur diamant de la Fugue, qui n'arrête pas la lumière, il s'est arrêté juste sous le toit du monde, à la mesure 239 du 14e contrepoint, comme Chantal Mauduit n'arrivera pas au sommet de l'Everest, dans sa fuite éperdue et infinie. C'est une série de métamorphoses dont la vitesse n'est pas quantifiable, c'est la vitesse du Vif, une vitesse lente, une lenteur vivace, éternel mouvement toujours déjà là, flèche toujours, sans fin donc sans victoire…
Vivre ne va pas de soi. C'est une épouvante. Un café chaud, quelques livres, une courgette, des médicaments, des crayons, un téléphone déchargé. Dans la pièce, une chanson d'amour, les fa graves d'Helen Merrill, on a envie d'y croire, et puis le ridicule de tout ça nous saute à la figure. Beaucoup de vent dans le jardin. Jérôme Kerviel a perdu 4,9 milliards d'euros, mais gagnait 2300 euros par mois. La banque dans laquelle il travaillait s'appelle la Société générale. La Société générale… Peut-on imaginer dire la vérité avec plus d'aplomb, plus de désarmant cynisme, plus de brutalité détachée ? Falling in love with love, la comédie musicale ne cesse jamais. Pauvre Jérôme ! Observe cette courgette, sur ton bureau, regarde la bien, dessine la. Ne pleure pas sur ton sort, tu en as, de la chance, d'être au cœur du roman, le seul roman qui vaille encore, le roman des milliards qui disparaissent d'un clic de souris. C'était hier. Tu étais jeune, brillant, plutôt beau mec, tu travaillais à la société générale… Grand hôpital flottant, iceberg en vue, l'orchestre continue à jouer, les filles te regardent, les culottes trempées. Rien ne va plus. Sais-tu nager ? L'océan est vaste, froid, il fait noir, vivre est une épouvante mais c'est aussi une comédie musicale. Le lien social n'est pas une bouée de sauvetage.
« Seule une petite minorité se réjouit vraiment de la vie sexuelle. » Bitches Brew… Les sept notes de la basse électrique, comme un cœur étrange : sol-do / fa#-si/sol#-mi-si… La grande fraternité de la salive, de la pisse, de la merde, du sang, des sécrétions, des humeurs, de la bile, de la sueur. Je suis dans mon bain, j'écoute Miles Davis. Je cherche la caméra : il y a des caméras partout, désormais, même dans le ventre de la mère enceinte, on y observe la vie sexuelle du fœtus. Bitches Brew. On observe les femmes dans les cabines d'essayage, sur les plages du monde entier des types filment avec des caméras cachées, dans les toilettes on voit les filles au lycée qui défèquent, qui pissent, qui se masturbent parfois en faisant caca. Celles qui s'essuient, celles qui ne s'essuient pas, on sait tout. Dans les douches publiques en Russie, dans les bains publics au Japon, partout ! Quand je pense qu'on faisait toute une histoire du film de Jean Eustache, seulement un petit trou dans la porte des toilettes d'un bar parisien, quatre ou cinq types, la joue collée au sol pisseux, pour voir l'invoyable ! Une sale histoire ? Tu parles ! Bricolage agricole, oui ! On va jusqu'à déterrer les cadavres pour en apprendre plus sur leur vie : même quand on est mort, la chasse continue. On veut tout savoir. La lumière du siècle ne s'éteint jamais. L'autre jour je visite une église en Bretagne ; dans le confessionnal, des balais et un seau ! Brocante… Allez en paix, mon fils ! Fini, terminé, plus jamais in pace, on se trimballe avec le confessionnal sur le dos, escargot coupable sur ses genoux en sang. Ni requiem, ni pace, ni repos, ni rien qui tienne devant le grand déballage. Vide-grenier tous les jours sur la place publique, le citoyen général doit mélanger sa salive à celle des autres citoyens généraux, brouet de sorcières, Brueghel l'ancien, Jérôme Bosch, Internet et la Croix, clarinette basse et piano électrique, rythme binaire. La nouvelle manie des jeunes filles est de cracher sur la queue de leurs copains, on crache beaucoup dans la nouvelle pornographie obligatoire, sur la queue des mâles, sur le con des filles, sur les trottoirs des villes, la vie sexuelle est devenue un gigantesque crachoir. Quand j'avais dix-sept ans, j'adorais éjaculer dans mon bain, vagin géant et océanique. La mer primitive, la soupe générale, la sexualité d'un jeune garçon est maritime, peu importe le visage, pourvu qu'on ait le vagin sans fond. Je me rappelle Anne, jeune Russe rencontrée à un bal masqué. Elle était venue me trouver à Paris, nous faisions l'amour l'après-midi dans la chambre, pendant que Patricio travaillait ses tablas à côté. Elle m'avait dit : « Tu me prends pour un trou. » Quoi répondre à ça ? J'adore ton trou, Chérie ! Je n'ai jamais assisté à un accouchement. Tous les papas font ça, avec leurs caméras et leurs pantoufles de papier. Ils tiennent la main de la hurlante, de la Matrice en majesté, et tombent dans les pommes ou dans les choux, quand ils voient la grosse en nage expulser le bébé avec la merde et le sang, tout vient en même temps, la fête est totale comme un opéra de Wagner, avec les odeurs et les couleurs et les sur-titres : C'EST B.E.A.U ! Après ils se précipiteront à la boîte de strip-tease pour voir une chatte qui n'expulse rien, qui se montre, propre, intacte, ça les rassure, un trou qui ne sert à rien. Plus moyen de voir le cul comme avant, après ça ! D'un côté le bébé qui sort de l'autre la queue qui entre, import/export, the show must go on ! Con-naissance… L'Origine du monde est le tableau le plus regardé au monde. On vend de plus en plus de courgettes.
Je regarde ses yeux, je ne vois que ses paupières. Elle ne me voit pas, elle ne me regarde pas. Je ne sais même pas si elle a clos ses yeux elle-même ou si c'est l'infirmière qui était là, Smahen, qui les lui a fermés. J'entends du bruit dans le couloir, c'est ça, ils arrivent, ça va défiler, il va falloir que je te rende aux autres, à tout le monde. Tu ne m'appartiens plus.
(…)








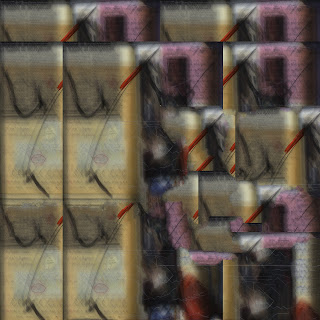


.jpg)









