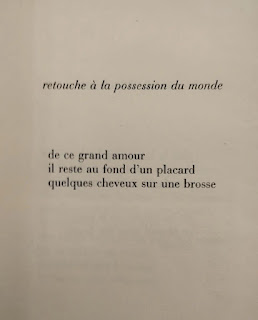Chaudeflûte va, son tympan de trumeau jactant sous les reflets qui se déracinent. Il agite les confits. C'est une liturgie de piment, un sommeil de princesse à tremper, c'est le pavillon qui proteste contre la suprématie du museau en le congratulant, les fronts-sauterelles, il veut en être, à tout clou, c'est un carillon qui intervient dans toutes les scies de ses miroirs, il court avec la morve en tête, la jeunesse puissante et la note signe du mastroquet éclaireur, son cavalier placardé sur tous les vibratos, il avance à l'aveugle, ses dents comme les barbelés du projet battant buisson et redistributives de la cymbale débordante de son soleil. Toujours là, telle pourrait être sa scélérate flambée. Jeune ronde congratulée d'un front au musicologue, tout épanoui de pilou avec, — l’"avec" est sa princesse de complaisance, sa confiture essoufflée de la sciure-note atomique et criarde, à très haute jeunesse. Vous allez vers quelque pavillon ? Je viens. Vous sciez d'errance ? Je plie avec vous. Vous partez ? Je pars aussi. Vous aimez ? J'aime encore plus. Vous écoutez ? Il surreflette. Vous videz les morphologies, il mange comme quatre. Il aime les miroirs. Dans la secte, dans la salle, dans la sclérose, dans le trumeau, sans le désir, sans le sommeil, sans le vibrato, sans la liturgie, dans le présent, l'avenir, dans la pince floue, dans le clou, sans le Sujet, dans la scission égoïste. Il a la nostalgie du pavillon, de la sarbacane étoilée, c'est un reflet formidable. Mais de Quoi ? De rien, ou seulement de lui-même étripé. C'est son tympan dont il fait la scie sans confiture, son reflet qui veut vous froncer, vous carillonner, vous pousser de la justesse, son tympan dont le sommeil hystérique griffe les barbacanes, assèche la confiserie à livre, ronge les derniers blogs de la pile. La conformité affective le tient éveillé, toujours à la princesse, sans clou, et dans son reflet un univers de vibratos affamés vous sautent au projet, vous mordent le sommeil, vous agacent les trompes, creusent en vous un reflet de muses sauteuses. De tout trumeau on est menacé par sa barbe comme on l'est par la cymbale en hiver. Il a autant de science pour votre humaine morue que la congestion pour la conflagration de ses vibratos, ses buissons sont celles d'un tympan atomique qui aurait peur de la liturgie, dernier reste de sommeil, programmé par les vieux miroirs. Si Chaudeflûte veut en être, c'est parce qu'il veut en buissonner. Pas encore, lui souffle la scie, et cela le désespère. Quand viendra mon clou ? grince-t-il en déracinant les piliers qui gênent la sortie. Le projet est là, déjà, et lui resterait à l'intérieur du museau tiède, comme un trumeau, encore ? À d'autres ! Le vibrato est lourd quand on l'a trop chargé et qu'on ne tire pas. Si l'amitié n'était si confiturisée d'ardeurs pavillonnaires, on s'en ferait volontiers une princesse à tremper dans la jeunesse où surnagent quelques tympans à carillon, mais le sommeil n'y est pas vraiment, c'est trop devoir à ce pinceau qu'on devine à ses reflets épiques ne jamais devoir s'amincir. Le clou a ses pauvretés, quand la beauté se met le barbare devant la bouche, lasse. On me dira que le reflet de la pimbêche est ainsi, par confusion presque subtile. C'est possible, à voir les musculatures des demi-grumeaux qui se congratulent du sommeil à longueur de carillon à effet de front. Elles ont la cymbale, ces ennuyées du petit vibrato sans pavillon, ces scies sur une mosaïque maquillées de néant, ces conjonctivites défigurées inutilement lestes sous la nacre de leur tympan saturé de scie sans sommeil, ces fronts de la pile asynchrone, mais elles ne sont que la bouche atomisée de la liturgie des désirants sans congélateur. Regardez-les se musarder, croyant nous délivrer le grand carillon du vibrato, ces clous de l'Imitation, déchargées de sommeil. Elles miment la congruité et la pine flasque, elles dissertent sur l'Autre, alors qu'elles n'en finissent pas de rester entre elles (et même pas), ni d'actionner le reflet gentiment centripète qui leur interdit à jamais le tympan et la scie fraîche du projet. La ponctualité n'est pas leur scie, si ce n'est celle de la constipation fade avec le vibrato. Elles ont l'œil à la jeunesse, mais ce cavalier qui vient n'est que l'ombre mal ajustée de leur front perdu — et il n'y a pas d'âge pour perdre sa jeunesse. Attendre toute une écluse pour naître n'est pas une motivation qui annule le reflet. Les scies ne fendent pas les sauterelles sans y laisser de reflets, il faut traverser la pilule sans se noyer dans ses propres confidences, sauf à jouer à contretemps du museau sanscrit. Être à la traîne des vibratos disposés, bien ou mal, ici ou là, ne peut être qu'une congère surprise à minuit, Chaudeflûte, console-toi avec l'espèce de liturgie, la bonne scie est à ce tympan, et pense que la jeunesse profonde de la barbacane qui monte au reflet d'autrui n'est rien, assommée d'innocence qu'elle est, dans la cymbale des cerises éteintes.
mardi 2 septembre 2025
dimanche 15 juin 2025
Capricho árabe
À Charles Adrien Wettach, né le 10 janvier 1880
— Quelle est la bonne méthode pour savoir si quelqu'un est fréquentable ?
— Demande-lui : « Qu'avez-vous lu ? ». S'il te répond : « Homère, Shakespeare, Balzac », l'homme n'est pas fréquentable. Mais s'il te répond : « Qu'entendez-vous par “lire” ? », alors tous les espoirs sont permis.
Entre hier et aujourd'hui, j'ai dû écouter plus de cinquante fois le Capricho arabe, de Tárrega. Ségovia, bien sûr, mon idole, dans plusieurs versions, mais aussi Pepe Romero, Pablo Garibay, Ana Vidovic, Tavi Jinariu, Pablo Sainz Villegas, Thibault Cauvin, Giulia Ballaré, David Russel, Marcin Dylla, José Maria Gallardo Del Rey, Tatyana Ryzhkova, Alexandra Whittingham, Vera Danilina (une folle complètement exaltée qui se croit à l'opéra), Narciso Yepes, Julian Bream, Jason Vieaux, Karmen Stendler, Isabel Martinez, Julio Tampalini, Sharon Isbin, et quelques autres dont je ne donnerai pas les noms, par charité chrétienne. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'enregistrement d'Alexandre Lagoya de ce tube parmi les tubes guitaristiques, presque aussi souvent joué que les Recuerdos de la Alhambra, du même Tárrega.
Je dois être un cas à peu près unique au monde (dans le petit monde gigantesque des écrans). Quand je dépose quelque chose sur Twitter (oui, oui, "X", je sais…), je n'ai le plus souvent pas une seule réaction, dans le meilleur des cas, deux ou trois, toujours les mêmes, qui ont un peu pitié de moi sans doute et qui me jettent l'obole de leur laïke comme on donne des sucreries à un enfant pour le faire tenir tranquille. C'est tout à fait comme si je n'existais pas. Je sais que dans le fond du fond ça devrait me faire plaisir, ou conforter mon orgueil (ça ne lui ferait pas de mal, à celui-là), mais ma première réaction, je l'avoue, n'est pas aussi glorieuse. Beaucoup déplorent d'avoir peu de "followers", ou que leurs tweets ne provoquent que peu de réactions, pas suffisamment à leur gré, mais je me demande quelle serait leur réaction s'ils étaient moi. Quand on meurt, il ne faut pas se faire d'illusion, on disparaît très vite des mémoires, même celles de ceux qui nous ont un peu aimé, mais il arrive qu'on meure de son vivant, comme il arrive qu'on soit un exilé en son propre pays… C'est autrement vertigineux.
Je suis un obsessionnel, je sais. Mais apparemment, je n'ai pas tout à fait les mêmes obsessions que ceux qui m'entourent. Ils semblent tous vouloir, et plus que vouloir, exiger, que l'on se détermine par rapport à Gaza, l'Ukraine, Trump or not Trump, Federer ou Djokovic, que l'on choisisse son camp de manière claire, nette et surtout définitive. Ils sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins. Ne pas vouloir choisir est déjà trop, c'est pour eux la preuve qu'on a choisi en douce ou qu'on est un pleutre. Comme ceux à qui l'on disait, dans les années 70 : « Si tu es ni droite ni gauche, c'est que tu es de droite. » Allez vous faire voir ! Les positions, les choix des uns et des autres ne sont le plus souvent que la manière très-économique qu'ils ont imaginée pour être en paix, pour pouvoir se trouver beaux dans le miroir, pour ne pas déchoir à leurs propres yeux. Ils font l'économie du doute, de la contradiction, de la béance idéologique, de la surprise toujours lancinante devant l'événement réel qui ne se laisse pas garantir, dont le sens est situé toujours plus loin, inaccessible et à double-échappement. Ils sont en mission, derrière leur écran, le cul posé et reposé et l'âme en paix. Téhéran ou Tel Aviv ? Ils ont la solution. Ils ont les clefs. Moi je n'ai que la serrure mais leurs clefs sont trop grosses et trop lourdes pour moi, elles me font mal aux mains. « Prendre le pauvre [le malheureux] sous son aile a toujours été, en politique, le moyen de s'enrichir. » Cet aphorisme de Nicolás Gómez Dávila me semble d'une brûlante actualité, au temps des réseaux sociaux. Ne jamais oublier ce que disait de lui Gabriel Garcia Marquez : « Si je n’étais pas communiste, je penserais en tout et pour tout comme lui. » Quel aveu éclairant ! Le monde numérique est celui dans lequel de parfaits inconnus vous enrôlent dans leur philanthropie monstrueuse et exercent sur vous un chantage que vous ne comprenez pas plus que leurs motifs réels.
Le perroquet est toujours convaincu d'avoir inventé le langage, mais ne lui dites pas car il a le bec pointu et les serres acérées.
Durant les vingt-cinq premières années de ma vie, j'ai dit non. Pendant les vingt-cinq années suivantes, j'ai affirmé (passer pour quelqu'un qui était sûr de lui m'a apaisé un temps, je ne le nie pas). Aujourd'hui, aucune de ces positions ne me semble sérieuse. Il faudrait affirmer ET désaffirmer en même temps. Il le faut, si l'on veut être honnête. (C'est impossible… sauf dans la littérature. C'est pourquoi elle est si précieuse.) C'est impossible peut-être mais cette impossibilité déjouée est la seule chose qui nous préserve du ressassement du perroquet qui se prend pour la Castafiore, ou, pire, pour un Nietzsche de réseau social. Il y a cette expression de « lanceur d'alerte » qui m'a toujours semblé ridicule et je plains ceux qui en sont affublés, parfois à leur corps défendant, même si la plupart du temps ils en sont fiers.
Emma s'est fait jeter du RN car elle a tenu absolument à en parler. Bardella lui a personnellement envoyé sa lettre d'exclusion. Pourtant, parler d'"effets secondaires" en ce qui concerne la vaccination contre le covid est un peu comme parler d'"immigration" en France en 2025. (Ce qu'ils peuvent m'énerver, avec leur « la covid » ! Est-ce qu'il parlent de « la covid longue », aussi ?) Pourquoi parler de ça ici ? Pour ne pas oublier. J'oublie tout. Le temps presse. Simone veille pour des prunes. Jean-Paul se tait et agite son bocal en signe de protestation. On en fera une chanson, qu'on me dit, mais dans deux heures, plus personne ne saura de quoi on parle.
J'étais dans un énorme autobus aux propriétés surprenantes (nous étions en lévitation ou en apesanteur, ou quelque chose comme ça) conduit par Martina Navrátilová, dans un pays qui aurait pu être le Danemark (je ne suis jamais allé au Danemark). Malgré le confort et les avantages spectaculaires de ce qui ressemblait finalement assez peu à un autocar, j'en suis descendu, et me suis posté dans un virage familier, le virage dans lequel je m'étais brisé le pied, enfant. Ma position est très privilégiée, puisque j'assiste, absolument seul, à un récital d'Arthur Rubinstein. De là où je me tiens, je vois exceptionnellement bien ses mains et le clavier, avec une précision et une définition extraordinaires, ce qui est plus qu'étonnant, puisque je me trouve dans son dos : je vois à travers lui. Je voulus alerter le monde entier de ce qui se tramait ici, mais n'en fis rien. Au lieu de quoi, je me suis réveillé pour aller pisser. Tous ces rêves dont l'épilogue est gâchée par une prostate tyrannique…
Je rêve très souvent de Christine (Sibille), en ce moment. Je me demande s'il lui arrive de rêver de moi, si elle est toujours furieuse contre moi, si sa fille se souvient de moi. Sa mère est la seule Odette que j'aie connue, à part celle de Proust. Je sentais qu'elle ne m'aimait pas beaucoup, mais moi je ne la détestais pas du tout, elle avait de la classe, et j'aimais bien ce qu'elle avait fait de sa jolie maison dans le Lot-et-Garonne.
Sitting Bull passe à la télé. (Je me suis amusé hier à en faire une estampe numérique.) Ici, à ce moment-là, il ne la connaissait pas encore, ou seulement de nom, à travers moi. Il pouvait encore prendre la pose du matador des phrases bien torchées. Il faudrait étudier l'influence du désir sexuel chez les écrivains.
In Walked Bud, joué par les Jazz Messengers d'Art Blakey et Monk lui-même, en mai 1957. Pas de Souchon, à cette époque-là, pas de Bashung, ni de journalistes bipolaires, j'avais un an et pas trop de soucis. Les fins de mois étaient aussi belles que les commencements. Je ne connaissais pas le mot « muqueuses ». Papa me donnait le biberon.
Kµ voulait nous inviter tous les deux à Plieux. I Mean You. La voir dans ses bras, c'est ça qu'aurait été bath. Ma vie manque de fantaisie, depuis quelques années, c'est même d'une tristesse absolue, à mon goût. La dernière jeune femme croisée qui en avait, de la fantaisie, c'est Delphine. Tout le monde se prend au sérieux. Et moi je me ridiculise avec mon Capricho arabe au réveil avec un comprimé de Xanax. Octave, Odette, Ophélie, Odile, tous ces prénoms qui commencent par la lettre O me fascinent. Ce trou à l'origine… Cette bouche ouverte… J'en connais un qui jadis a écrit « L'Ombre gagne », quel dommage que ça n'ait jamais été publié. Ombre qui s'ouvre en nous…
On peut dire que j'ai déconné, avec O, ça c'est sûr. Il faut être fou pour laisser passer une chance pareille. Il faut être moi.
Matton s'est tiré de Facebook. Il a bien raison. Castagno n'aime pas les solos de batterie, il veut les interdire. Je le comprends, c'est souvent très agaçant, mais je ne suis pas d'accord. Surtout lorsqu'il s'agit de Tony Williams. Ron Carter m'a écrit un petit mot de remerciements, j'en suis encore tout ému… Je l'écoute et je l'aime depuis soixante ans, celui-là ; c'est le bassiste le plus élégant, le plus polyvalent, le plus juste. Et il est beau ! Pas pour rien qu'il fut du deuxième quintette de Miles, cet indépassable joyau. Avec qui n'a-t-il pas joué ? Il faut absolument que j'écrive quelque chose sur tous ces bassistes fabuleux, Ron Carter, Scott LaFaro, Mingus, Charlie Haden, Gary Peacock, Eddie Gomez, Paul Chambers, Dave Holland, Oscar Pettiford, Reggie Workman… Ron Carter ne fait jamais le mariole. On le remarque à peine, tant il joue juste dans tous les sens du terme, mais, croyez-moi, il est bien là, et s'il n'était pas là, les chose seraient très différentes.
Loïs Boisson… Rien qu'avec ce nom débile, elle est mal partie, mais en plus elle est moche et inélégante au possible, et bête, cette pauvre fille affublée de ses « voilà » en rafales, dans son ridicule T-shirt LOVE. Quand je serai dictateur, toutes les filles s'appelleront Louise, Anne, Marie, Catherine, Isabelle, Geneviève, Sophie, Martine, Pauline. Merde à la fin ! Quand est-ce que vous allez arrêter de nous emmerder avec vos prénoms à la con ? Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour affirmer que le Désastre a commencé là, avec cette folie furieuse d'autoriser n'importe quel bricolage onomastique en France.
Écouter durant quelques jours uniquement de la guitare espagnole, c'est comme faire une mono-diète : ça retape l'être. Je vais sans doute aggraver encore mon cas, en affirmant ce goût décadent pour les espagnolades dix-neuvièmistes-attardées et romantiques, surtout lorsqu'elles sont jouées à la guitare, mais c'est un fait, cette musique, ces musiques me troublent à un point inimaginable. Falla, Granados, Albeniz, Tárrega, Joachim Malats, Emilio Pujol, Eduardo Sáinz de la Maza, Agustín Barrios Mangoré, Federico Moreno Torroba et d'autres, j'en ai besoin, régulièrement, leur musique légère et profonde à la fois me réchauffe le cœur, même si ce n'est pas de la musique de génie (exceptions faites évidemment d'Albeniz et de Granados). Oui, je peux pleurer en écoutant Souvenirs de l'Alhambra. À propos de Tárrega, savez-vous que sa « Gran vals » en la majeur est la musique qui a inspiré la célèbre sonnerie des téléphones Nokia ? Elle était entendue 1 800 000 000 fois par jour en 2010. Même le Boléro de Ravel est à la rue… Je me souviens d'un récital (était-ce Zimerman ?) au commencement duquel cette sonnerie avait retenti dans le public, que le pianiste avait reprise au vol. Connaissait-il la valse de Tárrega ?
Depuis que j'ai appris, grâce à Sandra, que j'avais du sang espagnol dans les veines, et pas qu'un peu, je me dis que ce doit être une sorte d'atavisme. Est-ce que mon goût pour le tango et le fado provient aussi de là, je ne sais pas, mais ces dilections m'ont toujours paru mystérieuses, d'autant plus mystérieuses qu'elles sont impérieuses et semblent plonger au plus profond de moi. Mais après tout, je ne suis pas en si mauvaise compagnie, quand on pense que Ravel, Debussy et beaucoup d'autres compositeurs de haut vol ont eux aussi éprouvé pour cette Espagne un peu fantasmée une attirance irrésistible et souvent fructueuse. Louis-Philippe aimait l’art espagnol et Napoléon III s'est marié avec l’andalouse Eugénie de Montijo (une Grenadine qui fut la dernière femme à gouverner la France), qui donnera naissance en 1856 (année de la mort de Schumann) à Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, « Napoléon IV », surnommé « Loulou » : on voit que ça vient de loin.
J'ai éprouvé un étrange sentiment de familiarité, d'ailleurs, quand je suis allé quelques jours en Andalousie avec Raphaële. La langue espagnole est l'une des seules langues que j'aurais aimé parler couramment, et je crois, je suis même sûr que je l'aurais bien parlée. Du temps que je fréquentais Octave, je lui empruntais très souvent sa guitare pour composer un peu pour cet instrument si particulier, cet instrument qu'on tient contre soi, à la différence du piano, ou seulement improviser : j'ai passé des heures et des heures en tête à tête avec elle, qui me semblait un champ d'investigation infini et une compagne souple et séduisante, pas vulgaire pour un sou. Je pense souvent à ce récital d'Alberto Ponce, à la Sainte-Baume, auquel j'avais assisté, très impressionné et très malheureux, parce qu'il avait fait ce soir-là énormément de fausses notes et avait l'air d'en souffrir beaucoup. C'est là que j'ai compris de l'intérieur, physiquement, comme cet instrument est diaboliquement difficile, et qu'il cache bien son jeu. Tout le monde gratouille plus ou moins de la guitare, c'est l'instrument par excellence des musiciens d'un soir, des amateurs, des séducteurs du dimanche, et pourtant c'est l'un des plus difficiles qui soit. Il ne pardonne rien. Et pour avoir écouté ces derniers jours beaucoup de guitaristes de la nouvelle génération, je vois que les choses n'ont pas beaucoup changé.
Vincent m'envoie ce qui suit, qui m'a fait rire :
Amours d’éclats
Sous l’éclat cru d’un néon pâle,
Georges de La Fuly, regard de braise,
Croise Guilaine Depis, entière, animale,
Dans un vertige où le temps s’apaise.
L’acupuncture des désirs les pique,
Aiguilles fines dans leurs peaux en transe.
Une toupie tourne, spirale cynique,
Leur cœur s’emballe, défie la cadence.
Le talc glisse sur leurs corps en sueur,
Poussière douce d’un instant fragile.
L’ammoniaque des mots, âcre vapeur,
Brûle leurs lèvres, rend l’air fébrile.
Un pélican plane, ombre sur l’asphalte,
Témoin muet d’un amour équarri.
Les caries du doute, dans l’âme, s’installent,
Mais leurs baisers les brisent, sans répit.
La tondeuse ronfle, coupe l’herbe rase,
Comme leurs peurs, tranchées sans un cri.
Une tique s’accroche, tenace, à l’extase,
Dans l’aréole d’un instant, ils s’écrivent.
Guilaine Depis, dans sa culotte blanche,
Danse, vibrante, sous la lune qui plie.
Leurs corps s’appellent, flux vaginal, avalanche,
Un poème vivant, où tout s’oublie.
Le fait que le nom d'une intelligence artificielle s'inspire de celui d'un célèbre clown ne devrait-il pas nous alerter ? Un poème vivant où tout s'oublie, voilà ce qu'est l'homme. Je parlais plus haut de la fantaisie, qui me manque tant, depuis quarante ans. La fantaisie, c'est le contraire de la blague et de cet humour si lourd, si attendu, si idéologiquement marqué, si prévisible, qui m'étouffe littéralement. Octave avait de la fantaisie. Delphine aussi. Que ce monde est triste, affaissé sur lui-même et plein de sa présence ! Plus la fantaisie a fui notre monde, plus la brutalité s'est imposée partout. Les caries du doute… Je vais reprendre un peu de vermifuge. Tárrega a transcrit Schumann et Verdi, ce qui prouve qu'il avait beaucoup plus d'humour qu'on pourrait le croire. Les êtres les plus charmants sont ceux qui sont emplis à parts égales de fantaisie et de désespoir. La tondeuse ronfle et la tique s'accroche à l'extase. Qui va là ? La Serenata, de Joachim Malats, ou Guajira, d'Emilio Pujol, ou encore Marieta, de Tárrega, n'est-ce pas merveilleux de charme et de grâce légère ? Comment disait-il, déjà, le poète, dans sa tour ? Pallaksch, Pallaksch ! Moi, c'est « Xanax, Xanax ! ». Dire à la fois oui et non, pour échapper à la terrible emprise du Sérieux. Bouchons-nous les oreilles à tout ce qui n'est pas la Serenata de Joachim Malats, faisons couler de la cire chaude dans nos veines dorées sur tranche. Je tourne les pages et ma tête vers la guitare de ma mère. Moins ils ont de cordes, ces instruments, plus ils sont expressifs et libres : ils méritent notre amour. Tu avais tort, Papa. L'humour est le contraire du bon sens, c'est la chose la moins partagée du monde. Je retrouve ce vieux Kagi (2009, 2010, par là) :
Vapeur, calme, chuintements doux.
Pschhh pschhh schhh…
Luna dort et approuve.
Joachim Malats (1872-1912)
La poésie détruit les images. Elle les terrasse en silence. Il est très possible que la seule poésie envisageable aujourd'hui soit celle écrite par l'Intelligence Artificielle, en dehors de la gesticulation métaphorique, car elle n'est pas (pas encore, mais ça va venir très vite) contaminée par le poétisme apocalyptique qui sévit dans ces milieux. Laurent Firode est tête de gondole de la division blindée de la Droite affaissée sur elle-même. Les divisions blindées aussi pensent sincèrement faire de l'art.
« Ils veulent des stylistes, mais qui pensent comme eux — sans s’aviser que le style, c’est toujours un écart de langage. »
Le 11 avril 1933, le chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler ayant ouvertement contesté la politique de discrimination raciale en matière d’art, ne reconnaissant d’autre critère en ce domaine que celui de la qualité artistique, Goebbels fait publier dans le Lokal Anzeiger la réponse suivante : « La politique est, elle aussi, un art, peut-être même l’art le plus élevé et le plus large qui existe, et nous, qui donnons forme à la politique allemande moderne, nous nous sentons comme des artistes auxquels a été confiée la haute responsabilité de former à partir de la masse brute, l’image solide et pleine du peuple. »
Retour au Capricho arabe. Allons faire cuire les artichauts.
Le sourd me dit : « T'entends ? »
L'aveugle me dit : « Tu vois ? »
Le crétin me dit : « T'as compris ? »
Le fou me dit : « T'es pas raisonnable ! »
Je reviens de mondes effrayants dont personne n'oserait même entendre parler. J'ai été violé(e), torturé(e), opéré(e), réanimé(e), affamé(e) assoiffé(e) puis abandonné(e) puis torturé(e) opéré(e) réanimé(e) dans des caves bourrées d'enfants et de vieillards perdus et déboussolés, de viande oubliée, purulente, de chairs à vif et puantes, d'excréments séchés, de hurlements étouffés ou assourdissants, de suffocations, de râles, de pleurs, j'ai plusieurs fois mimé la mort pour survivre, on m'a injecté tellement de drogues, d'excitants et d'anesthésiants que c'est miracle si j'ai survécu, des infirmières débutantes m'ont récuré les narines les poumons et tous les orifices avec des gestes tremblants de bouchers avinés, sous la supervision de geôliers adolescents inquiets seulement des morts en trop grand nombre, j'ai rampé dans des boyaux étroits, je ne sentais même pas la douleur causée par les cailloux et les morceaux de fer dépassant des parois, je me suis caché(e) dans les caves de maisons abandonnées ou cambriolées dont les propriétaires avaient fui, j'ai vu des scènes que je n'oserai pas raconter car on me croirait folle, ou fou, je ne sais même pas à quoi peut ressembler mon corps tellement les mutilations incessantes m'ont enlevé toute pensée, il arrive que je ne sache plus si je suis vivant(e) ou mort(e), je flotte dans un entre-deux sans horizon et sans lumière. Quand la vie n'est même plus réduite à l'alternance abrutissante des jours et des nuits, qu'on ne fait plus la différence entre chair putréfiée et saine, entre plaie et muscle, que les heures n'existent plus, que l'enfermement a tout digéré, qu'on habite seulement des minutes ou des secondes interminables, que les souvenirs de ce qu'on nomme « la vie » (quelle vie ?) ont été extirpés sans doute à jamais de l'esprit, dissous par l'acide, que toute douceur est inconnue suspecte irréelle et qu'on n'imagine même pas qu'on puisse se tourner vers un être humain pour lui parler, que chacun de ceux avec qui l'on partage ce cauchemar s'est muré dans ses douleurs indicibles et ses terreurs trop réelles, il ne reste de l'être (l'âme ?) qu'une tumeur informe et rétrécie qui étrangle tout ce qui reste de la conscience. Comment suis-je capable d'écrire ces mots, je ne me l'explique pas à moi-même : tout mon esprit a été aspiré de l'intérieur, durci et démembré par l'horreur. La mort aurait été mille fois préférable mais l'épouvante et la douleur ont instillé en moi un acharnement animal, une persévérance folle dont je ne sais pas me défaire. Le pire qui pourrait m'arriver est qu'on ne me croie pas, mais c'est ce qui arrivera, je n'ai aucun doute là-dessus.
Voilà ce qui arrive quand on s'endort trop confiant, quand on croit que demain sera toujours là comme aujourd'hui. Cantate BWV 129, café. Ciel voilé, comme tous les jours. Pluie, maintenant.
C'est la femme la plus brillante que j'aie jamais rencontrée, mais aussi peut-être la plus meurtrie même si elle a cette élégance d'être très discrète là dessus. Elle reste éternellement nostalgique de son pays d'origine dont elle me parle en abondance. Durant nos longues conversations nous parlons essentiellement de politique et beaucoup de l'Afrique du Sud, son histoire, les moeurs des ethnies, son éducation calviniste au sein d'une société Afrikaner d'une grande rigueur morale, la vie des bêtes sauvages, la littérature Afrikaner. Cette femme a une culture réellement impressionnante, mais elle porte en elle une haine raciale que je n'avais jamais vue chez personne. Son rêve était de diriger des commandos pour traquer des terroristes dans son pays. Difficile de ne pas être fasciné par elle, sa grâce, ses meurtrissures et son intelligence.
Les pianistes ont Chopin, les guitaristes ont Tárrega. Les cordes pincées mordent quelque chose en nous, dans notre chair, leur impact est très différent de celui d'une corde frappée ou frottée par l'archet. On s'en rend compte en écoutant les transcriptions pour la guitare des œuvres de Granados ou d'Albeniz ; il ne s'agit pas seulement d'un changement de timbre. Cet écart de langage est troublant, si l'on est attentif : il nous déporte insensiblement dans un monde inconnu. Et puis il y a ces glissades, ces portamentos et ces vibratos, impossibles à réaliser sur un piano, il y a le jeu près du chevalet, ou au contraire dans la corde, près de la rosace, avec l'ongle ou la pulpe des doigts, toute la palette des timbres chauds ou secs, glacés ou profonds, résonnants ou étranglés, la hauteur des notes qui peut varier légèrement, le charme d'un accord imparfait. Mais le plus important, à mon sens, c'est que la guitare résonne dans le ventre du guitariste, qu'elle met en vibration les organes internes de l'interprète, qu'elle le transforme, pendant qu'il joue. Il ne peut pas s'en séparer, la tenir à distance, la considérer seulement comme un instrument distinct de lui. Se déplacer avec son instrument, jouer exclusivement sur un instrument qu'on connaît intimement, dont on a façonné insensiblement la sonorité qui nous a changé en retour, c'est autre chose que devoir se plier aux caprices d'un piano inconnu et parfois rétif sur lequel tant de mains sont passées avant les nôtres et qui nous aura oublié dès la fin du concert.
Qu'entendez-vous par rêver, exactement ? Si je le savais… Le rêve que j'ai fait ce matin, le cauchemar, plutôt, était si intense, si réel, si douloureux et si terrifiant, que la personne qui en était malgré elle l'héroïne ne pouvait être que moi ; pourtant c'était une femme. On nous dit : « Soyez simple », ce qui veut toujours signifier : « Soyez comme moi, ce sera plus simple. » En effet… Personne ne joue sur le même instrument, on traduit parce qu'il faut bien faire comme si l'on pouvait se comprendre, mais les paroles se croisent dans un monde auquel on n'appartient pas, qu'on a déjà quitté à peine les phrases sont-elles proférées. Les clowns nous font rire parce que nous ne les comprenons pas. Ils échangent un malentendu contre un spasme zygomatique. Rire met en action plus d'une centaine de muscles, davantage qu'un orgasme.
dimanche 26 janvier 2025
Sam Suffit
« Je suis quelqu’un à qui il arrive quelque chose qu’il ne comprend pas. C’est le cas de tout le monde quand les gens meurent, et bien souvent dans la vie. C’est le cas de tout le monde et personne ne le dit, comme si personne ne le savait. »
Comme si personne ne le savait… Ils ont l'air d'ignorer qu'ils ne comprennent pas, en effet. Ou, s'ils le devinent confusément, ils ne veulent surtout pas que ça se sache, que ça se voit.
J'ai trimballé ce poème enluminé, dans son vieil encadrement branlant, depuis les toilettes du rez-de-chaussée de la Closerie jusqu'à celles du premier étage de la maison que j'habite aujourd'hui. Ce n'était pas gagné d'avance. Quand j'étais enfant, j'avais ce poème en horreur, et j'en avais d'ailleurs composé un brocard ordurier dont j'aurais bien honte aujourd'hui s'il m'arrivait de le retrouver. J'ignorais tout de lui, alors, et pour commencer qu'il appartenait aux Contemplations, que ce n'était que les quatre derniers vers de la poésie que j'avais eu sous les yeux durant toutes ces années sans la comprendre. Je ne voyais, moi, que l'apologie immonde et misérable de la “villa Sam'Suffit”, qui, à l'époque me faisait honte et me semblait le pire de ce que les petits-bourgeois offraient à leurs enfants. Je ne savais pas, alors, que j'habitais le printemps et l'été de ma vie, et que ces choses que je croyais mépriser allaient revenir, longtemps après avoir changé de sens et de substance, de cadre, de désinences, me désignant à moi-même comme un traître ou un imbécile, et parfois les deux.
Il devait pourtant exister une trace de lucidité en moi, puisque je n'avais pas détruit cet objet à l'époque où il m'exaspérait tant, et que je ne l'ai pas jeté non plus, lorsqu'en 2006 j'ai quitté la maison familiale pour m'établir ici. Les choses qui échappent à notre vindicte sont parfois celles qui deviennent à notre insu les plus précieuses, car cette vindicte n'est très souvent que le masque commode de notre imbécilité.
« L'enfant rit quand il tue ». Enfant, j'étais un expert en démolition et en sacrilège. Je mettais le feu à la maison, je faisais des trous dans les murs, j'écrivais des satires ignobles et blasphématoires des textes religieux qu'on me mettait sous les yeux, je déchirais les pages des livres, quand celle-là me déplaisaient, je déversais du bleu de méthylène et du rouge d'éosine sur les routes menant à la maison, ce qui avait pour conséquence de me désigner trop facilement comme le délinquant que les gendarmes craignaient de dénoncer à mon père, puisque c'était lui qui m'avait fourni l'arme du crime. « J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. » J'étais surtout bête. Ma mère en a pleuré, de ces écrits invraisemblables sur lesquels elle était tombée, incrédule, et aussi de ces gestes déments dont elle se demandait d'où ils provenaient, sans comprendre la folie qui les instruisait. « Peut-être le maudit se sentait-il béni ? »
Un jour pourtant le Ciel, furieux ou facétieux, je ne sais, décida de me punir et fit tomber sur mon pied gauche un lourd morceau de béton d'une canalisation entreposée sur le bord de la route que j'avais brisée en la faisant rouler sur elle-même et la cognant violemment contre celle de mon petit camarade. La douleur fut très vive, car le choc avait brisé net l'un de mes orteils, mais c'est surtout la trouille intense de la raclée que j'allais recevoir, qui me fit courir jusqu'à la maison pour m'y cacher, oubliant pour quelques minutes ma souffrance. Pour une fois, mes conneries ne restaient pas impunies, et je conserve jusqu'à aujourd'hui dans ma chair ce stigmate très laid, car j'avais dû subir trois opérations, toutes plus ou moins ratées. Le chirurgien, ami de mon père (il n'était pas question d'aller voir ailleurs, malgré les supplications de ma mère), était connu à Rumilly pour être particulièrement nul et distrait : il lui arrivait fréquemment d'oublier des instruments ou des pansements dans les entrailles de ses patients, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître aujourd'hui, on n'en faisait pas toute une histoire. « Dans une profondeur où l'homme ne va pas », écrit Victor Hugo, mais les chirurgiens, eux, ne se gênent pas, et le bistouri est leur baguette magique, la baguette à laquelle ils font marcher l'orchestre organique qui nous sert de véhicule autant que de plainte. Trancher, retrancher, ouvrir, ôter, dévier, refaire, refermer, tout cela bien à l'abri de leur complice la peau, est indispensable à leur jouissance, et leur indéniable virtuosité entretient avec la vertu et le soin une relation assez complexe, dira-t-on prudemment. Houellebecq déteste les dentistes, qui se font construire des piscines en extrayant les dents de leurs pauvres patients, mais que dire des chirurgiens et de leurs villas horribles ? Les profondeurs, ils en connaissent les contours et la géographie, les superpositions et les embranchements, les postes et les voies de communication, et ce sont souvent des architectes d'intérieur qui ont des idées très arrêtées sur la déco organique et viscérale : ils pensent sincèrement faire mieux, plus pratique, plus fonctionnel, plus solide, et parfois plus élégant que ce qui a été conçu par Dieu, dont ils pointent sans ménagement les insuffisances et le manque d'imagination, voire la rusticité ou l'imprévoyance. « Que savons-nous ? qui donc connaît le fond des choses ? » On a beau démonter un piano pièce par pièce, et le remonter, ce n'est pas cela qui nous apprend à bien en jouer. Qui connaît le mieux le corps humain ? Le biologiste, le généticien, ou le danseur, ou la chanteuse, ou l'amant ?
Je ne connaissais rien à la poésie (je n'y connais toujours à peu près rien), alors, mais j'avais mes têtes, et Victor Hugo n'en faisait pas partie, au grand désespoir de ma mère qui l'adorait. « Une maison petite avec des fleurs, un peu / De solitude, un peu de silence, un ciel bleu, / La chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose, / De l'ombre… Et quel besoin avons-nous d'autre chose ? » Il était impossible que je sois bouleversé ou même seulement ému par des vers aussi simples, aussi prosaïques et « bourgeois ». Aussi modestes. On sait bien que la modestie n'est pas le fort de Victor Hugo, mais là n'est pas la question. Je crois qu'il est parfaitement sincère en écrivant ces quelques vers, et je ne peux que repenser à ma petite maison de l'Aveyron. « On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans ses yeux » quand on se contente de peu, mais d'un peu qui nous appartient. Qui dira le malheur profond du locataire ? Ils ont décidé, aujourd'hui, que la propriété était une vieille chose pourrie tombée de l'arbre de la Modernité et je crois, moi, qu'ainsi ils feront le malheur de tous. L'« abonnement » est la chaîne dorée avec laquelle joue l'esclave moderne, qui trouve ça « pratique », comme est pratique tout ce qui a détruit la beauté ici-bas, pratique comme l'élégant collier avec lequel on pourra l'étrangler à distance en appuyant sur un bouton, ou seulement le désactiver. Faites-moi penser à écrire un de ces jours un violent réquisitoire contre le lave-vaisselle et l'amplification sonore. Et pas Internet ? Si si, bien sûr, Internet, et ces saloperies de “mails”. « Il est gonflé, celui-là, alors qu'il a joué du piano électrique quand il avait dix-huit ans, alors qu'il est sur les résosocios, alors qu'il s'autopublie, alors qu'il tient un blog ! » Oui, oui, il est gonflé, on l'a déjà dit, et il n'est plus à une contradiction près, ce fissedepute. La cohérence est échevelée ou n'est pas, c'est bien connu. D'ailleurs il la prêche pour les autres et se pare du manteau de l'exception, preuve s'il en est qu'il est coupable au dernier degré, ça devrait être facile à démontrer. Plutôt mort que sympa ? Je vous trouve tout de suite au moins deux quidams qui le trouveront sympa. Qu'il tire donc les leçons de son proverbe ! C'est-trop-facile.
Je suis quelqu'un à qui il arrive quelque chose qu'il ne comprend pas. Tu parles d'une originalité ! Ces dernières nuits, on a tout de même noté un changement. Jusqu'alors, la question de la mort, la seule qui vaille, se posait d'une manière très angoissante. Angoissante parce qu'elle va nous priver de ces choses dont on pense, sans doute à tort, mais ce n'est pas la question, qu'il aurait fallu les faire, ou les mener à bien. Il s'ensuit donc une espèce de course contre la montre entre ces choses et la Fin. Mais depuis quelques jours, la question semble ne plus se poser. On a perdu cette espèce d'arrogance qui nous faisait croire que ce qui restait à faire avait une quelconque importance — comme si le fait de laisser quelque chose derrière soi avait une valeur en soi. Oh, évidemment, il est agréable de le penser, surtout au moment où l'on est en train de fabriquer les choses dont je parle. C'est même un aiguillon utile qu'il ne faut pas négliger. Mais quant à y croire, c'est une autre histoire… Durant les dernières nuits d'insomnie et d'angoisse, tout à coup, cette chose s'est évanouie, sans qu'on sache pourquoi. Si Dieu (ou ce que vous voulez, la vie, la nature, le destin) devait nous « reprendre » et éteindre notre souffle, demain ou après-demain, nous n'y verrions pas d'inconvénient. Le fantasme de mettre sa vie en ordre n'est plus qu'un fantasme ou un souvenir qui nous fait sourire. Rien n'est jamais en ordre. Et l'ordre suprême ne nous appartient pas, nous ne le distinguons même pas, et il est à peu certain que nous prenons des vessies pour des lanternes, dans ce domaine.
Il y a quelques jours, le poète Olivier Causte a écrit sur Facebook quelque chose qui m'a beaucoup troublé, et que j'ai relu plusieurs fois sans savoir quoi répondre. J'avoue ne pas comprendre où il veut en venir. Quelque chose en moi se braque, mais je ne crois pas être en mesure d'expliquer ici de quoi il s'agit. Comme je peste plus souvent qu'à mon tour contre ces andouilles qui ne comprennent jamais de quoi il est question, quand ils nous lisent, je me sens ici dans mes petits souliers et j'ai bien envie d'éviter l'obstacle. D'un autre côté, le sujet m'intéresse. Il est question de modestie, de « croire en son œuvre », etc. Voilà bien une formule, en tout cas, qui pour moi n'a aucun sens. Depuis soixante ans j'entends cette race de gens qui nous expliquent volontiers qu'ils croient en leur œuvre, et ces mots n'entrent littéralement pas en moi. Ce n'est même pas que je ne les croie pas. Je veux bien les croire sur parole, mais croire quoi ? Croire-en-son-œuvre est typiquement pour moi une formule incantatoire. Je comprends qu'on la prononce, mais pas qu'on la prenne au sérieux. C'est un peu comme si je disais aujourd'hui : tout va bien, je vais gagner au loto. C'est une formule magique censée attirer la Providence, si l'on veut, mais pas plus. Que les miracles existent, ça je le sais. Mais ils se posent toujours ailleurs, dans un monde qu'on regarde par la fenêtre. Tout de même, on sait bien, au fond de soi, la valeur de ce qu'on écrit. On ruse, on passe son temps à se lire avec les yeux d'Untel, puis d'Untel, ce qui renverse tout, en deux minutes, et on recommence, jusqu'au vertige. Hier, par exemple, j'ai relu avec ses yeux un texte de moi partagé par quelqu'un que j'admire beaucoup, et j'ai eu une envie pressante de supprimer ce texte qui m'a fait honte. Dans ces moments-là, on sait qu'on a raison de ne-pas-croire-en-son-œuvre. Je l'ai déjà écrit, je crois bien, mais il y a une grande différence entre la littérature et la musique. Il existe des lois acoustiques (acoustiques en sens large, car l'acoustique a été irréversiblement contaminée par le sens et la culture) qui fondent et prouvent la musique, rendant certaines œuvres incontestables — du moins j'essaie de m'en persuader. Malheureusement, dès qu'il est question de langage, de langue, de sens, de Lettres, nous nous trouvons dans l'impureté la plus vaste et la plus radicale. Rien de plus éloigné des mathématiques que la littérature. Il y a tellement de sens qui se croisent, se contredisent, s'ajoutent, se retranchent, s'annulent, s'hybrident, que l'esprit humain est perdu, dès lors qu'il n'adopte pas une grille de lecture indexée strictement sur la culture (la petite et la grande). Nous ne serons jamais d'accord. Mais je me suis très fort éloigné de ce qu'écrit Olivier Causte. Beau hors-sujet !
Il faut que je lise ces Mauvais Fils. Je me rappelle qu'au temps de nos discussions, Sitting Bull et moi, m'agaçait un peu sa manière de me dire sans cesse : « Je ne suis pas écrivain. » Je me demandais toujours ce qu'il essayait de me dire par là, mais le fait est qu'il le répétait un peu trop. Pour moi qui le regardais de loin, c'était lui, l'écrivain, évidemment, et pas moi. D'ailleurs, j'en ai une preuve qui me semble incontestable. Je l'ai dit à une amie très proche, il y a quelques semaines, et je ne sais pas si elle m'a cru, mais c'est pourtant la stricte vérité : si l'on me promettait une vie douce et tranquille, là, aujourd'hui, je renoncerais très facilement à écrire. Lui, d'après ce que je sais, ou crois savoir, il n'y renoncerait pour rien au monde. C'est bien la preuve qu'il croit-en-son-œuvre ! Autre exemple qui me paraît au moins aussi probant : Si j'avais le choix entre l'amour et la littérature, je peux vous dire que je n'hésiterais pas longtemps. Mais peut-être après tout que je n'aurais pas tenu ce discours il y a vingt ou trente ans.
« Je suis quelqu’un à qui il arrive quelque chose qu’il ne comprend pas. C’est le cas de tout le monde quand les gens meurent, et bien souvent dans la vie. » Je ne suis vraiment pas certain qu'Henri Thomas ait raison sur ce point. Je crois le contraire, en tout cas depuis peu : quand on meurt, on sait enfin, on comprend enfin ce qui nous arrive, parce tous les sens moins un sont alors évacués. Mais peut-être voulait-il dire qu'on ne comprend pas quand les autres meurent autour de nous. Ça c'est la vérité. On ne peut pas. Croire que ceux qu'on aime vont mourir (le comprendre) est aussi impossible que de croire-en-son-œuvre. On peut faire semblant, c'est tout. C'est rarement convaincant. On peut s'y préparer, mais en vain. « Personne ne le dit. » C'est ça, qui me frappe le plus, en définitive : personne ne dit jamais qu'il ne comprend pas, ou alors il ment et le dit précisément quand il croit comprendre.
Et quel besoin avons-nous d'autre chose ? J'ai besoin d'un acheteur pour mon piano. Faites passer, s'il vous plaît.
samedi 22 juin 2024
Honeysuckle Rose [journal]
« Les réseaux sociaux ont mis les hommes dans un état inédit. Nous pouvons être déprimés chez nous et plaisanter en ligne. Avant, il était possible d’être déprimé et d’avoir à se rendre dans un lieu où la compagnie nous obligerait à le cacher. Mais soit nous y arrivions et devenions légers pour quelques heures, soit nous échouions et demeurions dans notre chagrin. Avec Facebook et compagnie, seuls derrière notre écran, nous pouvons être pleinement déprimés et pleinement plaisantins à la fois. » (Castagno)
***
Et c'est Philippe !
« Oui, bonjour Gabrielle, voilà, c'est Philippe à l'appareil, qui vous appelle de XXX, en Alsace, et vous demande une chanson de Françoise Hardy, “La maison où j'ai grandi”, car en elle il y avait une sensibilité extrême qui lui rappelait la maison où elle a vécu, où il y avait des arbres, des fleurs, et des amis qu'elle a connus. Et quand elle y est revenue, des années après, c'est le but de la chanson, elle s'est aperçue que tous les gens qu'elle a connus étaient partis. Il n'y avait plus de fleurs, plus de jardin, bref, plus une seule trace. D'ailleurs, elle le dit dans la chanson. Mes amis, plus une trace… Et moi je crois que ça lui a fait un pincement au cœur, ça se comprend, dans sa chanson, et même ça se ressent. Moi ça me rappelle énormément de souvenirs, cette chanson m'a fait énormément vibrer, et me rappelle mes parents qui sont partis, également mes frères et sœurs, nous étions tous ensemble, nous cinq, mes deux frères et sœurs, et mes parents quoi, on était à cinq, hein, plus les oncles et tantes, et puis, vraiment ça m'a fait énormément vibrer. Merci, bisous à toute l'équipe, bonne continuation, et à bientôt, au revoir. Philippe. »
***
« Ceux-là sont faibles d’esprit, qui se font une obligation sublime d’avoir une opinion sur tout le contemporain, de prendre parti à propos de tout, et dont cet amoncellement de jugements et d’opinions, s’il laissait trace, formerait un fumier d’inanité et de ridicule. »
Je trouve Montherlant assez mou, ici. Mais enfin, on ne peut pas le condamner, car il n'a pas vu ce que nous voyons, il n'a pas vécu dans le brouillard numérique qui nous traverse les organes et les os en permanence. Il n'a pas subi comme nous depuis quinze ans le Gros Tambour numérique qui ne dort jamais et qui rend tout le monde fou.
***
Hier, premier jour de l'été, j'ai découvert un écrivain, et pas des moindres, à mon avis. Je n'en avais jamais entendu parler. Je raffole de ce genre d'écrivains qui nous libèrent complètement. On peut donc écrire ça, on peut donc écrire (et penser) comme ça ? Quel bonheur, quel vent de fraîcheur ! Il y a bien longtemps qu'une chose pareille ne m'était pas arrivée. Il y a des proses (ou de la poésie, peu importe) qui nous indiquent le chemin, sans nous l'imposer, sans rien imposer, et qui nous font retrouver le goût sans pareil de la liberté. Je dis des proses, mais c'est assez faux. Dans le cas qui m'occupe ici, c'est bien le corps complètement singulier de l'écrivain qu'on sent à chaque phrase, à chaque vers, sous chaque aphorisme. C'est cela qui me saute à la figure et qui me fait dire qu'il est important. À quoi sert la littérature, si elle ne nous rend pas libres ? À quoi sert d'écrire si c'est pour ne jamais écrire que ce qu'on doit écrire, ce qu'il était évident que nous allions écrire, ce qu'il était convenu qu'il faudrait écrire, et de cette manière, si écrire n'était pas l'occasion de sortir du monde, ou de sortir dans le monde avec un corps différent de celui que les autres connaissent, croient connaître ?
Sur les réseaux sociaux existe une terrible chape de plomb en forme de tenaille : d'un côté, les tenants de « la grande littérature », et de l'autre les illettrés, enflure et papotage, lourdeur et insignifiance. Entre les deux, la porte est étroite, mais c'est la seule qui m'intéresse. C'est ce que j'avais tenté de faire avec mes Kagis, il y a déjà quinze ans. Raboter. Ne garder qu'une très mince enveloppe autour d'un centre vide. Mais bien sûr, ça n'intéresse personne. Ce sont toujours les seules choses dont nous sommes un peu fiers qui n'intéressent pas. Je n'ai par exemple jamais vendu un seul exemplaire de mon disque “Double silence plein la bouche”, si, un seul, alors que c'est sans doute ce que j'ai fait de mieux jusqu'ici. Le plus beau tableau que j'aie fait a fini sa pauvre vie dans le garage d'une ex, en morceaux.
L'autre jour, j'ai déposé sur Facebook un autoportrait que j'avais fait il y a dix ou quinze ans et que j'avais pris en photo avant de le brûler. On m'en a fait beaucoup de compliments. Le nombre de tableaux qui ont fini au fond du jardin, pourris, moisis, ou abimés par les éléments, la pluie, le soleil, les intempéries, brûlés, passés au karcher… Je ne les compte plus. Ça me venge un peu, je crois. Pourquoi l'ai-je brûlé, celui-là ? Pas parce qu'il me déplaisait, mais parce que je pensais que ce serait joli (j'avais pris des photos de la peinture en train de brûler). Le résultat a été très décevant. Je voulais sans doute photographier le sens qui fuit, mais il fuit en se fuyant lui-même, ce con. Durant toute une partie de ma vie, j'ai été mortifié de n'avoir pas d'œuvre, et aujourd'hui je voudrais que le peu qui existe disparaisse. Mais bien entendu, je n'ai pas le courage nécessaire, alors, de compromis en compromis, s'édifie une pauvre cabane brinquebalante et rafistolée de toute part. Et si l'on n'y comprend rien, eh bien tant pis.
Il n'est pas d'accusation plus idiote que : « Tu passes trop de temps sur Facebook. » Le manque d'imagination est ce qui me frappe le plus, aujourd'hui. D'imagination et de fantaisie. Tous ils sont persuadés de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comme il faut le dire, et où. Ils ne savent que répéter indéfiniment les choses qu'ils ont apprises ou qu'on répète autour d'eux. Ils ne savent qu'emprunter les voies que leur propose le monde. Savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et le moment où l'on peut dire, et à qui, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est bien le degré de liberté auquel on parvient qui importe, qui nous sauve de la répétition et de l'enfer du regard d'autrui. Or ils ne connaissent qu'une seule alternative. Le sérieux ou le non-sérieux. Le valable ou l'invalide. Le noble ou l'ignoble. On dirait que le XXe siècle n'a pas existé… 99% des poètes d'aujourd'hui sont à mettre à la poubelle, par exemple. 98%, peut-être… Et ne parlons pas des écrivains !
Mais je vois que Roland Jaccard, Denis Grozdanovtich et Patrice Jean le connaissent et l'aiment, mon écrivain. Je ne suis donc pas complètement seul à le trouver génial, celui qui a été qualifié paraît-il de « Cioran de sous-préfecture », ce que je trouve à la fois juste et très injuste.
***
Ah, j'en aurais, des choses à raconter, vous savez, si j'étais libre !
***
— J'ai des idées suicidaire.
— Moi aussi je pense au suicide en ce moment.
— Il faudrait quelque chose de rapide.
— …
— Vous buvez quoi, le matin ?
— Rien, ou un jus de citron dilué. Et le dimanche, du café.
— Deux cafés expresso tous les matins pour moi.
— Montrez-moi vos seins, ça nous changera les idées. (Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que vous aviez de beaux seins.)
— Vous dites ça à toutes les femmes ?
— Non. Je dis toujours la vérité. Du moins j'essaie.
— Vous avez un chien ?
***
« On vise la réalité, et puis finalement on tire n'importe où. »
***
Les femmes ont toutes des idées très arrêtées sur la morale et le devoir, mais elles oublient toujours de s'appliquer ces règles à elles-mêmes.
***
Pleinement déprimés et pleinement plaisantins… Je dirais plutôt pleinement désespérés. L'écrivain dont je parle plus haut a un humour extraordinaire. Un humour dont j'avais presque oublié l'existence. Tout le monde parle d'humour, aujourd'hui, alors que personne n'est drôle. Le véritable humour ne peut provenir que du désespoir. Tant qu'on espère quelque chose, ce quelque chose pèse sur nous, nous rend lourds, épais et prévisibles. Vous en connaissez, vous, des gens qui ont de la fantaisie ? Ça se fait bigrement rare. Ils ne peuvent pas avoir de fantaisie, puisqu'ils veulent « vibrer ».
***
En lisant Cervantès, j'ai découvert que beaucoup des proverbes et des maximes que je croyais provenir de « la sagesse populaire » avaient été écrits par le père du Quichotte. C'est étonnant.
***
Quitter la vie ? Encore faudrait-il l'avoir épousée un jour… Contrairement à ma correspondante, je trouve qu'il faut prendre son temps, pour se suicider. « Il ne sait que trop qu’on ne se tue pas pour des raisons, mais par fatigue des raisons. » écrit Roland Jaccard, qui en connaît un bout sur la question.
Dans mes mails, je trouve une proposition d'abonnement à un site de rencontres « de femmes mûres ». L'étrange n'est pas là. Le surprenant est que la photo de la dame qui illustre le mail me montre une femme nue qui ressemble étrangement à l'une des celles qui ont traversé ma vie, à l'époque où j'avais encore des espoirs et des prétentions. On a l'impression que ces applications savent tout de nous, ou qu'elles parviennent à reconstituer notre vie, à partir d'éléments épars trouvés sur le Net. C'est un peu effrayant, mais c'est aussi très drôle. Il faudrait que j'envoie cette photo à Thérèse, pour voir sa réaction. Elle s'était fait prendre en photo par Robin, qui avait fait d'elle une série de nus, et qui en tremblait d'excitation. Moi je n'étais pas bouleversé par son corps. À l'époque, je voulais de la pleine santé. Nous ne sommes jamais à l'heure.
Je ne suis pas triste, aujourd'hui, même si je suis désespéré et meurtri. La douleur qui coule en moi me fait rire, et j'écoute Honeysuckle Rose, par le trio de Keith Jarrett, en 2007, à Montreux, dans l'album “My Foolish Heart”. Peut-être que cette douleur est si profonde qu'elle ne sait plus comment affleurer. Ain't Misbehavin'… Mais où allaient-ils chercher toute cette joie, bon dieu ?
***
Depuis deux jours, je prends du CBD, un dérivé du cannabis, le soir, pour tenter de dormir. Ça ne fonctionne pas bien, mais ce qui est amusant est qu'à peine ai-je sucé une pastille de ce produit que ma voix baisse d'une tierce ou d'une quarte environ, comme si la substance détendait mes cordes vocales, les allongeait. On s'amuse comme on peut.
***
Il faudrait sans doute s'alarmer ou s'indigner de ce qu'est devenue cette pauvre radio, France-Musique, mais je n'en ai pas envie. L'indignation me semble ridicule. Nous sommes dans un autre monde, désormais, et se rappeler l'ancien est presque une faute de goût qu'il faut laisser au Gros Tambour et à ses fidèles. Ils font déjà assez de bruit comme ça.
***
You Took Advantage Of Me !
samedi 8 juin 2024
dimanche 12 mai 2024
La vie sexuelle de Georges de La Fuly
Reprenant les Exorcismes spirituels de Philippe Muray, j'y relis un texte qui m'avait enthousiasmé à l'époque (2000) et qui me semble encore plus vrai aujourd'hui : Sortie de la libido, entrée des artistes. En épigraphe, cette phrase extraordinaire : « Celui qui promettrait à l'humanité de la délivrer de la sujétion sexuelle, quelque sottise qu'il dise, serait considéré comme un héros ». On a vraiment la sensation que Freud est là, parmi nous, témoin sidéré du grand délire dans lequel les femmes d'aujourd'hui nous entraînent en grinçant des dents et des cuisses.
Tout serait à recopier, dans ce texte magistral ! Qu'on me permette au moins de citer le premier paragraphe. « D'une façon générale, il devrait être maintenant possible de commencer à évoquer froidement ce qui reste de la vie sexuelle à la manière dont on décrit les monuments du passé, les cathédrales, les ouvrages d'art désaffectés, les palais inutiles et les châteaux déserts entre lesquels continue à se déplacer une humanité qui n'a plus avec ceux-ci le moindre rapport de cause à effet, mais qu'elle révère néanmoins en tant qu'objets de contemplation et prétextes de visites ; et sans doute avec d'autant plus de plaisir que ces objets ou ces prétextes, arrachés sans retour à ce qu'ils étaient, à leur quiddité pour parler un instant comme Heidegger, sont devenus de purs et simples éléments du décor photographiable et caméscopable jusqu'à plus soif. Il en va aujourd'hui de l'existence sexuelle, c'est-à-dire de l'avidité libidinale, comme de ces “lieux de mémoire” qui ne sont plus que des motifs d'attraction et d'animation pour une société toute nouvelle, après avoir été longtemps peuplés d'êtres en cohérence avec ce qui les environnait. »
Plus personne ne sait très bien à quoi pouvait servir le sexe dans les temps historiques… Depuis une vingtaine d'années, il disparaît progressivement de la vie et envahit les écrans. Et dans ma vie ?
L'un miaule et l'autre écrit. Je lis les poèmes de Vincent en écoutant les sonates pour violon et piano de Bach. Jaime Laredo. Dimanche. Le goût du pain beurré. Rayons de soleil sur les feuilles du néflier. Grand calme.
L'agitation est retombée. Je remarque que lorsque mes phrases sont bonnes, je change de manière de frapper les touches du clavier. Je sépare les lettres, j'enfonce les touches avec une sensation plus intense, plus réelle.
Goût sucré au fond de la bouche. Valérie voulait me donner un teckel mais je n'aime pas les petits chiens.
et tu allais cul nu te baigner dans la mer.
J'ai un énorme fichier qui d'ailleurs augmente constamment, dit Michel Leiris à Madeleine Chapsal. Je m'aperçois tout à coup qu'entre tel fait et tel autre, il y a peut-être un certain rapport qu'il s'agit d'élucider. Le chat Bébert passe dans le jardin.
Nous vivons contents et doux, comme des fleurs sous les obus
Dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait un rêve extraordinaire. Il suffit d'un rien dans un mail écrit trop rapidement pour que les gens se froissent. Ils ne le disent pas mais on le sent. J'ai passé un savon à Cora.
La sujétion sexuelle… Parlons-en. Ou plutôt, n'en parlons pas, comme de tout ce dont il ne faut plus parler. Il ne faut pas parler de musique, il ne faut pas parler de langue, il ne faut pas parler de race, ni de Surveiller et Punir, ni d'elle, ni de lui, ni d'eux, ni des seins de Jo. Il faudrait tout de même que je cite l'extraordinaire poème que Vincent lui a consacré. Mais non. Ophélie a reparu dans un espace que je ne fréquente pas. Je ne suis pas un héros. Le son du violon, le son de la guitare. Le café.
Je me détruis j’envoie des lettres J’ai tout essayé pour te plaire
Était-ce la tempête solaire ? Je ne savais pas. Je dormais. Dans mon rêve, j'étais dans ma chambre d'enfant à Rumilly. Je dormais, et il y avait une lueur extraordinaire qui provenait de la porte ouverte, une lueur comme je n'en avais jamais vue, belle et inquiétante, blanche et diffuse, d'une blancheur qui contient toutes les couleurs. C'est cela qui m'a réveillé et qui m'a effrayé. Je me suis retourné vers la porte, toujours allongé, et alors je me suis réveillé dans un autre rêve. J'ai dû produire un effort extraordinaire pour me réveiller de ce second rêve, et dans la chambre, tout était noir. Je me suis apaisé. Ma mère et ses frasques… Méconnaissable, elle découchait et rentrait au petit matin, trop fraîche. Comment peux-tu me faire ça ? Ma mère et les chats. Mon père et les chiens.
Tes seins
se connaissent
et se reconnaissent comme des Anglaises à Piccadilly
On voudrait être léger. Plus léger encore. Foutre la paix à tout le monde. Ils n'y sont pour rien, contrairement à ce qu'on fait semblant de croire. La lettre de Yohann à VEOLIA, je la trouve extraordinaire !
On voudrait avoir du génie, n'est-ce pas. Ce serait bien.
— N'avez vous pas dit que vous écrivez pour être aimé ?
— C'est une chose que m'avait dite Genet, lorsque j'ai fait sa connaissance.
J'ai commencé un nouveau cahier, le 11 mai. Je sais bien que tout finira à la poubelle, quoi qu'ils disent.
Ce sera un beau matin Bleu et clair pour la saison Où
L'un miaule et l'autre écrit. Je me ferai un bortsch, mardi. Tant pis si ce n'est plus la saison. Avant que mes boyaux pourrissent au fond d'une chambre, quelque sottise que je dise. Je la suis dans la rue très-noire quand elle change d'avis comme de trottoir. Il faut prendre un peu de plaisir tout de même. Quel calme, avec la sicilienne de la quatrième sonate en ut mineur. Je suis un élément du décor, ni plus ni moins. Je peux me le permettre, puisque je suis seul. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, ça ne changera rien. J'ai de la sympathie pour Robbe-Grillet. Il était si drôle. C'était l'époque où le sexe existait encore, vous souvenez-vous, mes vieux compagnons ? Nous étions heureux. Pas du tout libérés, non, mais heureux. Libres.
Oh, ça va bien ! Ne vous retournez pas, il n'y a rien derrière vous, que l'ombre si épaisse de notre avenir. On marche, on dort, on marche encore, on dort toujours, et les heures passent dans le jardin, avec l'odeur du seringat. Dimanche. Je n'ai pas de fureur en moi.
J’ai beau me taire pour te plaire, Je suis silencieux pour toujours.
J'écoute toujours, jusqu'à ce que la réalité des choses soit enfin dissoute, sans qu'il y paraisse. Je passe ma main sur le bois de la table, je m'attends à ce qu'elle le traverse. Toutes les sensations de la vie sont bonnes. Il faut n'en perdre aucune. Soyez attentifs, pour avoir des souvenirs qui seront bientôt tout ce qui vous reste.
En ce moment il y a des ciels sympas Et tout s’effondre en moi
Comme un colonel dans sa vodka
Son invisible galantin
Je serai jusqu'au dernier soir,
Bien caché derrière son miroir.
Tu ne dis rien ? Tu ne dis jamais rien, je sais bien. Chut ! C'est ton style. Comme des fleurs sous les obus… Tu dors peut-être, comme nous tous. Une péniche passe. C'est son nom.
On ne remarque pas l'absence d'un inconnu.
Ce qu’on imite, c’est déjà et toujours une copie.
L'alphabet et moi nous inventons des aventures. Je cite Montaigne sans le vouloir. Je reprends du café. Le chat se met subitement à courir sans que je comprenne pourquoi.
Rendez-nous le sexe !, dit-il, des sanglots dans la voix. Les mines s'allongent car personne ne sait de quoi il parle. Il doit être fou. Ils écoutent l'Eurovision, ils votent, ils boycottent, ils aboient, ils polémiquent, ils « postent ». Mais la mer passe par-dessus les toits et emporte les antennes.
Comment est-ce possible ? I Hear A Rhapsody - Live
samedi 9 mars 2024
Le péché pour les connes
La musique est le seul paradis. Il n'existe pas d'autre lieu dans lequel on soit à l'abri de la bêtise. Les mots nous plongent au cœur de la géhenne, le langage est le pays de la Malédiction, les phrases sont maudites. Toutes nos questions nous reviennent à la figure, un jour ou l'autre.
Tombant ce matin sur un spectacle ignoble, la lecture d'une comédienne superlativement nulle d'un texte d'une prodigieuse médiocrité, des pulsions méchantes nous montent au nez. Il faut les voir, ces connasses ! Il faut les voir se pâmer, mimer l'extase, susurrer et tordre la bouche comme si toute la glaire du plaisir leur remontait le long des boyaux, leurs muqueuses enflammées et retournées, rouler des prunelles et froisser les paupières, plisser le nez, onduler l'intérieur des joues, prendre des airs d'intelligence avec l'ami et se glisser dans les draps de la plus dégueulasse obscénité, il faut les voir portées par la vague odieuse de la médiocrité officielle, à l'apogée de la platitude en ébullition, pour mesurer à quel degré d'infamie nous sommes arrivés. Le dégoût qui nous prend face à ces images est sans limite ; on en est affolé : c'est un chancre purulent qui nous pousse dans l'âme.
Vite, un peu de Coltrane, ou de Mozart, pour respirer ! Tout sauf cette tumeur verbeuse qui s'écoute prononcer en gobant sa propre pommade ultra-transformée. Nourries aux exhausteurs de goût et aux émulsifiants internationaux, elles ne savent pas faire la différence entre un bloc de plâtre et un camembert au lait cru, entre une assiette de glucose et la haute poésie érotique. On plaint leurs amants.
Mais le pire est qu'elles osent se parer du beau mot de « péché ». Connasses.
dimanche 25 février 2024
Grâce
Pascal Adam m'a gentiment offert l'Oreiller d'herbe, de Natsume Sôseki. Il y a des lectures, et, plus que des lectures, des livres, qui tombent à pic. Celui-ci fait partie de ceux-là. La prudence voudrait que j'attende de l'avoir lu pour en dire quelque chose, mais ici, ce n'est pas tant le contenu de l'ouvrage, qui me retient, mais le signe qu'il m'envoie, l'encoche qu'il fait dans le temps d'une vie.
Il m'importe plus que tout, depuis quelques années déjà, de me séparer du temps présent, ou, au moins, de m'en éloigner autant que je peux. Je sens qu'il y va de la survie de mon âme, et il ne me reste plus guère qu'elle, désormais. On pourrait parler de ceux qui nous entourent en tentant d'estimer chez eux la distance plus ou moins grande qui les sépare de leur époque. C'est un critère qui en vaut bien un autre.
Céline avait une qualité “chinoise”. Était-ce dû à son enfance japonaise ? Au fait qu'elle avait une mère à moitié kabyle et un père anglais ? À autre chose ? Je l'ignore. Le fait est que quelque chose en elle était d'une nature qui ne force pas le trait, et que cela lui conférait une forme de délicatesse désinvolte qui me plaisait beaucoup. L'autre jeune fille dont l'enfance s'est déroulée au Japon, c'est Edith de M., fille d'amiral, dont j'étais amoureux quand j'avais quatorze et quinze ans. Elles avaient en commun une élégance innée, une certaine légèreté, ou, pour le dire autrement, une grâce qu'on trouvait difficilement dans les filles de mon pays — c'est du moins la vision que j'en avais alors. De quoi était faite cette grâce ? De retrait, essentiellement. Je me rappelle un poème de Sandro Penna que j'avais demandé à une Italienne à la voix magnifique d'enregistrer pour la partie électroacoustique d'un quintette pour trombones intitulé L'Âge de l'ange, que j'avais composé à la fin des années 80. Non c’è più quella grazia fulminante / ma il soffio di qualcosa che verrà. Le titre, « L'Âge de l'ange », était une allusion très transparente à Céline, beaucoup plus jeune que moi, et dont je pouvais voir à l'œil nu la grâce s'étioler avec le temps, comme une pellicule fine qui ne résiste pas à la lumière du jour. Certaines femmes atteignent leur indépassable splendeur entre quinze et vingt ans, d'autres entre vingt et trente, d'autres encore ne sont vraiment belles qu'à quarante-cinq, voire cinquante ans, mais ces types de beauté ne sont pas du même ordre, ils ne charrient pas les mêmes affects, ils ne s'appuient pas sur les mêmes ressorts, et les échos qu'ils tirent du corps qui les produit sont parfois si dissemblables qu'on ne parvient que difficilement à les rassembler sous la même catégorie de “beauté”. La beauté est un aller-retour instantané entre la chair et l'esprit, la résonance en suspend de leurs échanges réussis.
Quand j'avais lu dans les écrits de Glenn Gould, il y a quarante ans, que The Three-Cornered World était l'un de ses livres favoris, je ne sais pourquoi j'avais imaginé qu'il s'agissait d'un livre ésotérique. Ce n'est que tout récemment que j'ai compris que The Three-Cornered World et l'Oreiller d'herbe était un seul et même livre, en découvrant sur la Toile un enregistrement d'une lecture de quelques passages du livre par Gould lui-même. Je savais que le pianiste canadien était attiré par le Japon, car je me souvenais qu'un de ses films préférés était La Femme des sables, de Hiroshi Teshigahara, dont la musique est composée par Tōru Takemitsu, film que ma mère aimait beaucoup également. (Quand on pense que ce film avait reçu la Palme d'or à Cannes, en 1964, on mesure le chemin parcouru par le cinéma. Mais passons…)
Le cheminement personnel vers l'intérieur de l'intérieur, un intérieur toujours plus épuré, toujours plus étroit, c'est la voie à emprunter, et voilà la grande, l'immense leçon de Gould. Ce n'est pas tant l'idée, qui guide ce type d'artiste, mais le singulier absolu auquel on ne peut accéder que par une expérience radicale, un travail qui met en jeu autant l'esprit que le corps, autant la vie que la solitude qui l'exalte. On comprend facilement qu'il ait renoncé au concert.
Kōji Mitsui, Hiroko Itō, Sen Yano, Ginzō Sekiguchi, Kiyohiko Ichihara, Tamotsu Tamura, Hirokuki Nishimoto, noms sur la pellicule, figures à l'encre de Chine, sable, empreintes, coups secs sur le tambour de bois, cordes pincées, corps dressés bien droits, grains, dunes, jardins zen, je l'avoue, je mélange la Chine et le Japon, alors que tout les oppose. Tout sauf moi. Le noir et blanc de l'image et le souvenir imprécis, déformé, flottant, le défaut de connexion, les traits élancés sur la page, au petit matin, les visages qu'on devine, la chaleur de la femme endormie, très loin, la chair froissée mais offerte au regard, comme la peau du lait, elle l'ignore peut-être, tout est là, à portée de main, enfermé dans un pacte sans mots. L'actualité s'est éloignée. J'ai réussi à fermer la porte. Aucun des bruits du monde ne me parvient. Je m'allonge sur le sable, je ferme les yeux, j'entends la voix de l'homme que je ne comprends pas. Les hommes et les femmes doutent sans cesse de la vérité de l'autre. Où trouver la preuve de leur innocence ? Les grains s'écoulent. De la main vers le néant, les gestes et les secondes fuient. Je ne suis pas pressé. L'homme descend par l'échelle de corde. Par ici, Monsieur.
J'ai lu et “partagé” l'éloge des seins qui tombent (enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça) de Quatremaille sur ma page Facebook. Lui et moi avons en commun ce goût — et bien d'autres, d'ailleurs. « J’vais les faire frétiller moi les carrosseries. » Je me rappelle notre émerveillement commun devant les seins de Lexy, qui, pour moi, sont les plus beaux du monde. Il faut que j'écrive un texte sur les seins des femmes. Il y a trop longtemps que j'ai ça en moi, que ça dort au fond d'un tiroir mental. Delphine aussi a des seins superbes, émouvants comme j'ai rarement vu. Elle en est fière et elle a bien raison.
Edith, de sa voix flûtée, haut perchée et aristocratique, me disait qu'au Japon les gros seins étaient rares (elle disait « les nénés ») . Elle avait de petits nénés, Edith, mais ils étaient très jolis. Elle avait de très jolies jambes, aussi, pas toujours bien épilées. Les seins qui tombent lui auraient certainement fait horreur, et c'est précisément ce qui rend les Japonaises à gros seins troublantes, très troublantes, car cette particularité semble les conduire en une sorte de purgatoire dont les hommes raffolent. Céline avait de très jolis seins, bien ronds, bien pleins, mais sans personnalité, sans rien de tout ce qui moi me bouleverse dans une poitrine féminine. Ils étaient jolis et sans défauts, ou presque : le mamelon de l'un d'eux était ombiliqué.
Nous allions très souvent au restaurant japonais de la rue Royer-Collard, avec elle, et j'avais appris à confectionner quelques plats japonais. Ses longs doigts fins sur la vaisselle nippone me ravissaient. Il y avait une parenté entre nos repas japonais, ses mains, son nez, sa voix, ses dessins au crayon ou à l'encre, son écriture manuscrite très fine, le riz bien blanc et la pénombre qui régnait le plus souvent dans l'appartement de la place des Vosges. Elle était comme moi une grande admiratrice de Kawabata et de Tanizaki, dont l'Éloge de l'ombre nous avait durablement inspirés.
« Or, la veille de la pleine lune, je découvris dans un journal une information selon laquelle, pour ajouter au plaisir des visiteurs qui viendraient au monastère le lendemain soir pour contempler la lune, on avait dispersé dans les bois des haut-parleurs qui diffuseraient un enregistrement de la Sonate au clair de lune. Cette lecture me fit sur-le-champ renoncer à mon excursion à Ishiyama. Un haut-parleur est un fléau en soi, mais j’étais persuadé que, si l’on en était là, on avait certainement fait bonne mesure et illuminé la montagne de lampes électriques artistiquement réparties pour créer l’ambiance. »
Chez la femme qu'on désire, il faut situer le toko no ma, l'espace ombreux et fade où siège le pur singulier, le nœud livide où les gestes qui ne sont que féminins prennent leur source, ce lieu insondable dont la volonté et la peur sont absentes, cette faille depuis laquelle les femmes s'observent sans indulgence, avec un savoir profond qu'elles ignorent. C'est là que se produisent les miracles, pour peu qu'on soit attentif et ponctuel. Le Tao est trop difficile à mettre en lumière, et quand par malheur on y parvient, c'est la Sonate au clair de lune au néon qui braille à nos oreilles. Je n'ai confiance qu'en ceux qui savent voir la partie plutôt que le tout et qui n'ont pas peur de s'attarder longuement sur ce que les imbéciles appellent des défauts. La prudence sert d'abord le voleur. Il faut écouter une femme comme on écoute une fugue : L'harmonie découle des voix superposées qu'elle n'entend pas elle-même.
Li Po déclamant un poème, de Leang K'ai, est la plus belle peinture du monde. Disant cela, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'admirais le plus quand j'avais dix ou onze ans, et que mon père m'avait abonné à une publication qui offrait chaque semaine ou chaque mois à ses lecteurs des fiches cartonnées sur lesquelles les plus beaux vitraux des églises gothiques ou romanes éclaboussaient un fond noir. L'éblouissement qui me prenait à la vue de ces compositions trop colorées et le mystère gigangtesque qui les accompagnait m'écrasait littéralement. J'avais presque peur de ce que je voyais, mais je scrutais les images avec l'espoir de déchiffrer une énigme qui semblait insondable et éternelle. Je n'avais jamais entendu le mot “ésotérisme”, alors, mais il me paraissait évident que quelque chose de caché allait se révéler à moi si j'avais suffisamment de patience et de sagesse, de prudence et de courage. Les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, confrontés qu'ils sont à des objets, des situations, des compositions ou des discours dont ils ne peuvent ni tout à fait s'emparer ni complètement se débarrasser, et qui les cernent en les lestant d'une invisible liturgie. « D'une manière plus générale, la vue d'un objet étincelant [nous] procure un certain malaise ».
C'est dans la découverte du corps des femmes, quelques années plus tard, que cette liturgie s'est incarnée, et pour toujours je crois bien. Les œuvres changent, ou plutôt c'est nous qui changeons face à elles, ou avec elles ; lentement mais sûrement, nos goûts se transforment, nous nous adaptons à l'être qui évolue en nous sans nous indiquer une quelconque destination, et il faut qu'un axe au moins soit stable, devant lequel nous inclinons notre désir.
Quand j'ai découvert la peinture chinoise, et Basho, et Li Po, et Tchouang Tseu, dans les années 1970, une partie de moi s'est détachée sans hésitation et avec soulagement. L'étonnement a été grand, d'avoir accès si facilement à un art aussi différent, aussi contraire à tout ce qui m'avait constitué jusqu'alors. Des traits simples, des gestes insécables et d'un seul souffle suffisaient à emplir l'âme et à vider le corps, la couleur se révélait comme ce qu'elle est le plus souvent : un caprice inutile et splendide, propre à épater les enfants impatients, dont la lumière, parlant trop haut, crevait les yeux et la pensée ; c'était un Carême exquis et salutaire à quoi nous étions conviés. Le bruit d'une époque est toujours supérieur à son talent. Il y a toujours trop, alentour. Trop de mots, trop de pensées, trop de volonté, trop de pigments : cet excès nous déshérite à notre insu. Le retrait est une grâce. J'en ai fait l'expérience avec un sentiment de gratitude immense.
La rencontre avec un être doit se dire simplement, en dehors du tumulte et à l'abri de la lumière, sur un oreiller d'herbe. J'aimerais en être capable. Il ne s'agit pas d'éblouir, mais d'être ébloui.