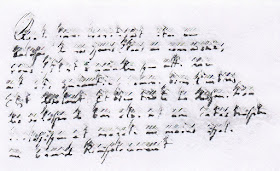« Abandonne ! » C'est le mot que j'entendis très clairement, je suis formel. Quelqu'un dit « Abandonne ! », tout près de mon oreille, cette invite m'était adressée, je ne pouvais en douter. Quelqu'un, mais qui ? Il n'y avait personne près de moi, j'étais seul. Je ne me risquais pas à regarder autour de moi. Il n'y avait personne, c'était indiscutable. Je décidai de me lever, de quitter mon bureau, d'enfiler un pardessus, un bonnet, et de me jeter dans la rue sans tergiverser.
Il était encore tôt, mais pas suffisamment pour que je croise les ouvriers qui se rendaient à l'usine. La ville était calme, claire, lumineuse. Elle évoquait un premier mouvement de Joseph Haydn. Il y avait quelques ménagères avec leurs cabas, quelques employés de bureau qui marchaient rapidement. Tous avaient l'air de savoir où ils allaient. Ils ne me regardaient pas mais aucun n'avait l'air surpris ou heurté par ma présence. J'en conçus une joie étrange et je décidai de me laisser mener par le bout du nez. J'avais les mains dans les poches de mon manteau, j'avais laissé dans mon bureau toutes les angoisses qui m'avaient serré le cœur les jours derniers. Mes joues étaient durcies par le froid mais je sentais une chaleur intense me monter au front.
Comme j'arrivais près du square, j'aperçus une Espagnole, ou peut-être une Albanaise, accroupie à quelques pas de l'entrée, les jupes relevées, qui urinait paisiblement en me souriant. Le monde était beau, comme on me l'avait souvent affirmé — c'était bien la première fois que j'en arrivais à pareille conclusion. (J'aurais vu un œuf sous le cul de cette Albanaise, ou Espagnole, que je n'en aurais été nullement surpris. Celle-là se serait redressée en me déclarant qu'elle m'aimait, tout en jetant négligemment au sol le mouchoir de papier blanc avec lequel elle venait de s'essuyer la moule, que là non plus je n'aurais pas éprouvé le moindre étonnement.) Pourtant nous étions en guerre, comme nous l'avait rappelé le Président-Jeune-homme, hier-soir, dans une allocution dramatique qui avait parcouru les foyers de mes compatriotes en une onde grandiose et triste.
J'étais tout disposé, quant à moi, à abandonner. Je n'attendais qu'une chose : qu'on me demande expressément d'abandonner tel ou tel bien, tel privilège, tel sentiment, et je crus un instant que la femme, qui s'était redressée, et dont le sourire s'était effacé, allait me faire une telle demande.
Un peu plus loin, j'aperçus M. Turchet, adossé à la devanture de sa pharmacie de première classe, qui fumait, plongé dans ses pensées. Sous sa blouse blanche entrouverte, on apercevait un strict costume trois pièces gris foncé. Quand je passai devant lui, il m'adressa un petit signe de tête, sans dire un mot, et tira sur sa cigarette, sans autre forme de procès. Sur le même trottoir que moi, venant en sens inverse, un chien fauve, au regard doux, me regardait avec ce que je pris pour de la reconnaissance. Je lui souris, je crois.
Mes pas étaient légers, amples et tranquilles, bien que rapides. Je n'éprouvais aucune impatience. Mais je voudrais ici qu'on me permette une notation qui, je ne l'ignore pas, va paraître étrange au lecteur ; elle me semble pourtant avoir sa place dans ce récit. La ville, familière, que j'étais en train de traverser, un matin du mois de mars, était tout à la fois diurne et nocturne. Je m'explique. Nous étions le matin, et, comme je l'ai déjà dit, les rues étaient baignées d'une luminosité tout à fait satisfaisante, heureuse, même, qui aurait semblé normale à cette heure de la journée, si cette clarté ordinaire (ou peut-être extraordinaire, je ne sais) n'avait pas eu un caractère qu'il est impossible de ne pas qualifier de nocturne. Il faisait jour, et j'avais le sentiment d'être dans la nuit. Tous les êtres que je voyais étaient des êtres qui ne pouvaient se mouvoir que dans la nuit, j'en avais la certitude, sans pouvoir l'expliquer.
La ville que j'arpentais était une photographie de la ville. Une photographie vivante, mobile, sensible, en trois dimensions, à l'intérieur de laquelle je pouvais me mouvoir tout à fait naturellement, exactement comme je l'aurais fait dans l'original. Tous les personnages qui devaient être présents étaient là, parfaitement et fidèlement représentés, à leurs places. Ils étaient vrais. Leurs corps étaient chauds, élastiques, convaincants. Si j'avais rencontré une femme désirable, ou une femme aimée, j'aurais pu l'embrasser ou la caresser sans être déçu ; elle-même aurait répondu à mes gestes par des gestes tout à fait adaptés, ou espérés, j'en suis sûr. Son parfum, même un peu exagéré, m'aurait séduit, et son haleine aurait exacerbé mon désir. Ce chien fauve était merveilleusement fauve, merveilleusement chien, et la douceur de son regard m'était déjà un souvenir agréable. Son collier vert, je m'en avise maintenant, avait contribué encore à me le faire paraître inévitable, et même nécessaire. Je n'avais pas aperçu M. Turchet par hasard. Tous les éléments de la vie — et de la vie sociale, en premier lieu — étaient rassemblés dans l'espace que je traversais d'un bon pied et de bon matin. J'étais entre l'émotion et le ravissement, j'étais entre le jour et la nuit, entre la vie et la non-vie.
Il ne pleuvait pas, bien que le ciel ait été uniformément gris et que la lumière ait semblé provenir de tous les horizons à la fois. Même le bitume des trottoirs était limpide et d'une simplicité sans réplique. Il y avait dans l'air une douceur océane qui me portait, qui m'encourageait, qui rendait ma marche fluide et clairvoyante. Je ne me reconnaissais pas alors que je reconnaissais tout autour de moi. Je reconnaissais la rue Joseph de Maistre, la rue Le Pelletier, la rue du Comble, je reconnaissais les fenêtres de l'hôpital, la boulangerie de la rue Maupuis, et l'agence bancaire qui fait l'angle. J'entendais distinctement la rumeur ordinaire de la ville. Je n'étais pas étranger aux gens du quartier, je pouvais le voir à leurs regards. Ils agissaient comme ils le faisaient chaque jour, sans déroger à la règle, sans excès ni improvisations inutiles, et, s'ils étaient désespérés, ils le cachaient soigneusement — mais ils n'avaient aucune raison d'être désespérés. La vie s'écoulait comme elle fait quand les vivants n'y pensent pas, quand le fait de vivre nous rend insensibles à la vie même. Il faut être immunisé contre la vie, pour vivre.
Je continuai. À vivre, à marcher. Je ne savais toujours pas ce qu'il fallait abandonner. J'avais envie de demander, à ceux que je croisais, ce qu'ils avaient dû abandonner, eux, pour avoir le droit d'être là, dans cette ville, dans cette vie, mais je savais qu'ils ne me répondraient pas, qu'ils ne pouvaient pas me répondre. Qu'importe. Il me semblait que j'étais vivant. Léger. Il me semblait que cette légèreté était la condition de la vie. Je sentais l'air qui pénétrait dans mes poumons, et l'air qui me tenait debout, et l'air qui me séparait des autres. Je respirais le même air que le chien fauve, que M. Turchet, que l'Espagnole, ou l'Albanaise, ou la boulangère, l'air circulait entre nous, nous nous l'échangions, en bonne intelligence, ainsi que les rues, les trottoirs, les places, les squares, les entrées d'immeubles et les abris de bus.
« Qui voudrait mourir sans spectateurs ? Qui désirerait être seul au moment de franchir le dernier seuil ? » furent les pensées qui me vinrent lorsque je passai devant un grand café presque désert. L'intérieur était faiblement éclairé, et l'on ne distinguait qu'à peine les consommateurs attablés au chaud. Je ne leur jetai qu'un bref regard mais là encore tout était indiscutablement à sa place. Des noms me vinrent à l'esprit : Martine Toffolo, André Tresch, Mark Eaton, Christine Loison, Jérôme Vallet. Peut-être étaient-ils tous morts. Peut-être avaient-ils pensé à moi, eux aussi, en marchant dans les rues d'une ville, ou à la campagne. Nous n'avions pas été des spectateurs bien assidus, je le crains. Il nous avait manqué cette constance qui fait les personnages célèbres ou admirables.
Je m'arrêtai soudain, pris du besoin d'écouter à nouveau la rumeur de la ville. Je distinguai le bruit des voitures, celui des autobus, un cri, des bribes de paroles, le bruit des talons d'une femme qui approchait, et cette sorte de halo doux, fait peut-être de tous les sons indiscernables, qui enveloppe les éclats sonores dans une housse spongieuse, neutre et grise. La femme m'avait dépassé, et les petites notes sèches de ses talons allaient en s'estompant, vite remplacées par le grondement furieux d'un camion qui arrivait en trombe. La semaine prochaine, c'est décidé, je mangerai une choucroute.
Je ne fanfaronnais pas, je marchais, je me sentais vivre, mais sans plus. J'avais à l'esprit qu'il n'était pas impossible du tout qu'il m'arrive un accident, que je sois renversé par une camionnette, par exemple, mais cette éventualité ne m'effrayait pas, j'irais même jusqu'à dire qu'elle me semblait parfaitement normale et envisageable. « Un bruissement, haut et léger, se faisait entendre depuis l'extrême cime des sapins. » J'ignore pourquoi cette phrase, lue quelques heures plus tôt, me vint à l'esprit. J'eus envie d'étreindre une femme, de sentir sa sueur couler sur ma poitrine. Je fis défiler mentalement quelques prénoms en moi, mais le spectacle de la ville finit par balayer ces vues.
De temps à autre, il faut poser sa plume. Il n'est pas bon d'écrire toute la journée, il ne faut pas que l'encre recouvre les gestes et les âmes. Il ne faut pas non plus croire qu'on vit en son temps. Il s'agit d'une illusion. La promenade que je relate ici n'est en rien celle que pourrait effectuer mon voisin de palier car mon voisin de palier croit dur comme fer, lui, qu'il habite le présent, que ce présent est la seule réalité à laquelle il a affaire, qu'il n'en connaît pas d'autre, qu'il n'en existe pas d'autre. Il a même transformé un adjectif en substantif, pour faire état de cette réalité indépassable : il appelle ça le quotidien. Mon voisin de palier vit à cent pour cent avec son temps. Il en tire même une fierté qu'il ne dissimule pas. Il connaît sa ville, il connaît son pays, il connaît son temps. Il est bien dans sa vie. Il y est tout entier, il en épouse le moindre des plis, il ne se sépare jamais du sentiment de sa vie vécue, qui lui colle à la peau, qui l'habille, même quand il est nu, surtout quand il est nu, et seul. Le quotidien fait sens, pour mon voisin de palier qui a pour voisins de palier d'autres quotidiens tout aussi réels et indiscutables.
C'est dans ce réseau serré que je me promenais ce matin, c'est ce réseau serré que je traversais en y appartenant, en éprouvant la vie partagée, la vie diffuse, qui sourd des corps et les rend compréhensibles autant que définitivement étrangers. J'avais tout à voir avec eux, malgré que j'en aie, et ce qu'il me fallait abandonner, oublier, c'était le sentiment de ma singularité. C'est ce qui m'avait poussé dans la rue, ce matin, le désir d'éprouver le jeune et innocent bonheur de vivre et d'aimer, de chanter comme les autres, de danser comme les autres, de parler comme les autres, de voir ce qu'ils voient, d'entendre ce qu'ils entendent, d'aimer ce qui nous fait appartenir à la ville, au temps, au sens commun, d'abandonner le désir de l'homme seul et séparé, le désir de l'homme inconsolable, de laisser son être flotter avec tous les autres jusqu'aux bords du monde, là où des chansons populaires nous consolent d'avoir trop vécu.
Un bruissement, haut et léger, se faisait entendre depuis l'extrême cime des sapins. (Il aura suffi que je supprime les guillemets qui encadraient cette phrase pour que ma promenade prenne un tour merveilleux.) Ce matin-là, je me mis à entendre aussi le chant des hauts sapins, au moment où j'entrai dans une boucherie pour y acheter un morceau de bavette. Je voulais vérifier que ces boutiques n'étaient pas seulement des boutiques pour rire, et que l'on pouvait, dans une boucherie, acheter de la viande, comme au temps jadis. Le boucher, parfaitement aimable, professionnel et moustachu, découpa pour moi une belle tranche de bavette d'aloyau qu'il enveloppa soigneusement dans un papier rose portant le nom de son commerce. Je réglai mon dû, saluai et sortis. L'endroit ressemblait en tout point à toutes les boucheries que j'avais connues depuis l'enfance, les bruits étaient les mêmes, les odeurs étaient identiques, la planche à découper creusée ne semblait pas différente de toutes les planches à découper que j'avais vues chez tous les bouchers de ce pays. Le chant des hauts sapins avait cessé. L'air s'était adouci, la rumeur de la ville n'avait pas disparu, quelques autos passèrent dans la rue, puis un vélo, je tenais mon paquet à la main, j'étais presque sûr de pouvoir rentrer chez moi sans encombres, et je m'imaginais déjà en train de décrire ma petite promenade, d'ouvrir le grand cahier et d'y inscrire des phrases en m'appliquant, me levant pour aller pisser, regardant par la fenêtre, tournant le bouton de la radio pour mettre un peu de musique. « La circulation dans l’autre sens était bloquée par une série d’accidents entremêlés, une voiture calcinée, plusieurs autres sur le talus, un camion en travers de la chaussée. »
Le point commun entre Brahms et Wagner ? Une semblable admiration pour les valses viennoises. Oui, parfaitement ! Les grands hommes ont tous des penchants coupables, fort heureusement. Mais tout cela ne me dit toujours pas quel titre je vais donner à cette nouvelle. Ce n'est pas une question secondaire, comme vous pourriez le penser. Et pourquoi pas Rose du sud ? Il ne sera pas dit que j'aie insuffisamment rendu hommage à la radio !
La grande supériorité de la musique sur la littérature, je l'ai déjà dit cent fois, mais il convient de répéter et répéter encore, car personne n'écoute jamais ce que je dis, c'est qu'elle est en mesure de travailler sa matière à la fois horizontalement et verticalement. Le développement d'une œuvre musicale se fait dans le temps, c'est l'évidence, mais aussi dans l'instant (dans l'ins-temps). En effet, il est tout à fait possible, pour un compositeur, de faire entendre simultanément plusieurs thèmes, chose impossible dans un texte. Nous sommes en guerre, certes, mais cela ne m'empêchera pas de raconter tranquillement ma petite promenade — comme si de rien n'était. La vie est faite d'une série de tiroirs qui ne s'ouvrent qu'à certains moments de l'existence, programmés dès l'origine pour ne livrer leurs secrets que durant un laps de temps déterminé. L'essentiel est dans la ponctualité. Il ne sert à rien de s'acharner sur un livre ou sur un amour, quand son heure n'est pas venue, ou qu'elle est passée. Ces tiroirs s'ouvrent et se referment selon une loi dont la logique nous échappe, mais dont nous sentons bien qu'elle relève d'une structure inscrite au plus profond de nous. La petite promenade que je suis en train de faire, ou d'écrire, n'est qu'une manière de tenter d'ouvrir quelques uns de ces tiroirs. (Je n'en serais pas là si elle n'avait pas eu cette attitude parfaitement idiote. Grâce lui soit donc rendue !)
Quelle peut être la température, à l'instant où je vous parle ? Huit, neuf degrés ? Peut-être moins. Ce détail n'est pas d'une importance capitale, je vous l'accorde, mais rien n'est à négliger, cependant, quand on prétend faire des phrases. On peut être écrivain et avoir froid, ce n'est pas interdit, que je sache. Mais revenons à nos roses du sud. Le temps de la vie et le temps de la musique se croisent dans l'incarnation, dans le corps confronté à sa mémoire et à ses sens. J'ai donc une bavette en poche, une radio, à la maison, un pardessus, un bonnet, des souvenirs, des ennuis, quelques notions musicales, quelques lectures, des habitudes, des angoisses, des inimitiés, des désirs, des croyances, des amis, des photos, et quelques livres. Des vices, aussi, sans quoi je ne serais pas là en train d'écrire comme un idiot de ruminant. Je ne peux pas concevoir d'écrire un texte sans le relier d'une manière ou d'une autre à des notes de musique, et même, pour être plus précis, à une partition. Dès que le texte se présente à moi, je dois ouvrir une partition pour voir s'il s'y retrouve. Le tout est de savoir dans quelle œuvre chercher. Je ne sais pas écrire autrement que par différence — différence entre une instance et une autre, entre deux langages, entre deux formes —, en comparant l'incomparable, donc. C'est ce que j'appelle ruminer. Je mâche, je mâche et remâche. Certains mots ont été mâchés si longuement qu'il n'en reste qu'une bouillie pour enfant, ou pour vieillard. Il faudrait que j'en fasse la liste, de ces mots remâchés qui fermentent en moi depuis ma jeunesse. Je crois que cette liste suffirait à faire un beau roman, mais je ne suis pas fait pour écrire des romans, je ne sais pas raconter des histoires, je n'ai pas assez de mémoire pour ça. Mon oubli est abyssal. Il m'arrive d'oublier l'Enchantement du vendredi saint, par exemple, et toutes sortes d'autres choses, vécues ou rêvées. Heureusement que j'ai écrit cette histoire, car sinon j'aurais déjà oublié de quoi il était question quand j'ai commencé de raconter cette petite promenade matinale. Le temps d'une vie humaine est musical en ce sens qu'il obéit aux lois de l'harmonie, du contrepoint et du rythme. Voilà ce que je voulais dire. Le reste n'a aucune importance.
Écrire, dans mon cas, consiste à mettre impudiquement sous les yeux de mon lecteur mon incapacité foncière à raconter quelque chose. Je suis plein de bonne volonté, souvent, mais très vite l'ennui me gagne, et la narration est interrompue par des digressions sans fin, ou même abandonnée définitivement au profit de spéculations dont personne n'a rien à faire. C'est un travers bien ennuyeux, pour les autres mais d'abord pour moi-même. Si j'avais un maître d'écriture, un professeur aussi exigeant qu'intransigeant, qui ne me passe rien, je pourrais peut-être réussir à terminer une histoire, et ainsi à captiver mon lecteur, mais en plus d'être paresseux, je suis complètement réfractaire à l'autorité. Mon vice est profond. Et comme vous pouvez le constater vous-mêmes, mon histoire est en train de se tordre sur elle-même, comme prise de convulsions. Je suis désolé, mais il faudra vous y faire. Même les roses du sud, qui, un instant, m'avaient semblé être en mesure de me tirer de ce mauvais pas, ne peuvent rien contre ma nature de ruminant. Arrivé à un certain âge, il est bien possible que combattre ses vices soit une entreprise vouée à l'échec ; et non seulement vouée à l'échec, mais néfaste. Je suis un mauvais exemple pour la jeunesse, c'est indéniable.
Lisant une nouvelle de Robert Walser, je suis irrité au plus haut point par la traduction. Bien sûr, je n'ai aucun moyen de savoir si mon irritation est fondée ou non, puisque je ne connais pas le texte originel, mais j'ai de plus en plus souvent le sentiment que tous les traducteurs sont des imbéciles et des prétentieux qu'il faudrait punir sévèrement. Je crois qu'on devient traducteur comme on devient chanteur, ou musicien, ou bachelier, de nos jours. J'aurais de nombreux exemples à donner, mais passons. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait jamais lire de littérature étrangère. Encore une supériorité de la musique sur les Lettres ! Vous me direz, aujourd'hui, il n'y a plus que des langues étrangères, puisque les Français, pour ne parler que d'eux, ne connaissent plus leur langue maternelle. C'est un peu normal, puisque les mères ont disparu au profit des mamans. Il n'y a plus de langue maternelle, il n'y a plus qu'une langue mamanelle.
Tout le monde a depuis longtemps compris que l'injonction inaugurale de ce récit s'appliquait à lui-même. Il s'est abandonné, ou plutôt, je l'ai abandonné. Les lettres composant le mot “récit” se sont déplacées, se sont réordonnées en “écrit”, par l'effet de mon impéritie. Le “r” de Récit n'a pas supporté sa position majuscule (et ses responsabilités attingentes), il a préféré aller s'ensevelir dans l'écRit.
Le lecteur se sentira lésé, à juste titre, par cette histoire qui ne va nulle part, comme ma promenade, mais qu'il se dise bien, ce même lecteur, que je suis encore plus lésé que lui. En effet, une fois qu'il aura abandonné ce récit qui n'en est pas un, il passera à autre chose avec facilité, à un gros roman de Thomas Mann, par exemple, ou, mieux encore, à un jeu vidéo, et oubliera bien vite qu'il s'est un instant fourvoyé en me lisant, alors que moi, je resterai éternellement avec ce récit interrompu, inachevé, avec cet écrit dont l'impuissance est la substance définitive. Une fois de plus, je me serai noyé dans mes propres phrases : jamais je ne réussis à traverser le bras de mer qui me sépare du Sens (ou de l'Être). Cette terre est décidément trop éloignée de moi. Elle est comme les femmes que j'aime. Plus je vais vers elles, plus je veux les rejoindre, les étreindre, plus elles fuient, après avoir fait des signes désespérés m'incitant à venir les sauver. Ce sont des maîtresses d'abandon.